 11/11/2020
11/11/2020

Datura officinal : l'épouvantable épouvantail!
Datura stramonium (Datura officinal ou Stramoine) appartient une famille de Sauvages un peu sorcières, celle des Solanaceae, de la Mandragore (Mandragora officinarum), de la Belladone (Atropa belladonna) ou de la Morelle noire (Solanum nigrum). Autant de plantes réputées pour leur toxicité ou leur pouvoirs psychotropes, due aux alcaloïdes qu'elles synthétisent. Mais de la sorcellerie à la ratatouille, il n'y a qu'un tout petit chaudron: ce clan est aussi celui de nos chères Tomates, de la Pomme de terre, du Poivron ou de l’Aubergine.

Floraison tardive (juillet à octobre) du Datura officinal: la «Trompette de la mort».
A un moment, le sorcier s’est mis à nous menacer avec ses parties génitales.
(Kaamelott, Alexandre Astier)
Sorcier hérissé chez les Solanacées, le Datura officinal est précédé par son aura sulfureuse. En témoignent ses multiples surnoms: il est l'Herbe aux fous, l'Herbe du diable, l'Herbe aux sorcières, la Pomme poison ou la Trompette de la mort... Datura dérive de l'arabe tatorâh, où l'on retrouve la racine du mot tat, «piquer» : son surnom le plus célèbre est sans doute la Pomme épineuse, à cause de ses fruits gros comme des noix (des capsules) couverts de robustes épines.
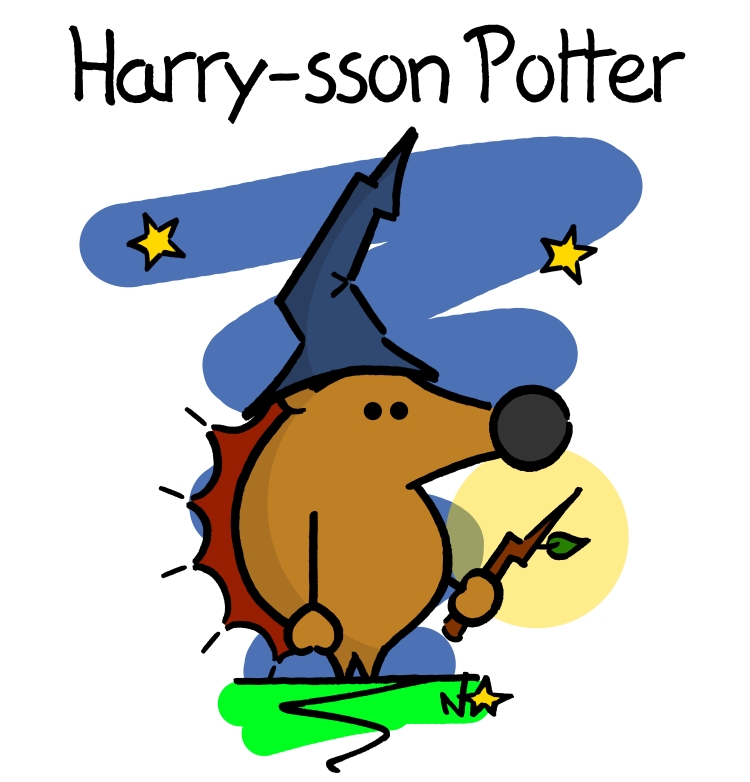

Datura officinal ou Pomme épineuse, Île de Ré (17)
Le Datura est une annuelle robuste qui pousse dans les champs cultivés, les friches, les décombres... Il aime les sols fraîchement retournés, de préférence frais et riches en nitrates (issus des amendements et/ou de la pollution). C'est une adventice bien connue des cultures maraichères, mal venue à cause de sa toxicité, car pouvant «contaminer» certaines récoltes (farines, conserves, maïs ensilé pour le bétail...).

Datura officinal: 40 centimètres à 1 mètre de hauteur pour ce sorcier qui ne manque ni de force ni d'élégance.
L'évocation de la toxicité du Datura n'étonnera personne. Il n'est gère difficile de dénicher ici et là des citations qui évoquent les usages anciens du Sauvageon dans des rites magiques ou chamaniques: fumigation hallucinogène (en fait délirogène) sur le continent américain, charme magique en Afrique du nord (philtre d'amour) ou en Inde (breuvage abrutissant), potion «zombi» dans les rites vaudous en Haïti...! On retiendra surtout que la dangerosité du Datura est avérée, dans toutes les parties de la plante, et que sa consommation a généralement pour conséquence une hospitalisation. On ne joue pas plus avec le Datura qu'avec le feu.
Et puisqu'on parle de feu: ne brûlez pas les pieds arrachés, la fumée alors provoquée étant toxique si inhalée. L'histoire de France se souvient d'ailleurs d'un gang de vauriens connus sous le nom d'endormeurs (18ème siècle), qui offraient à leur victime un tabac coupé aux semences de Datura, profitant ensuite de leur délire ou de leur assoupissement pour les détrousser!

Semences toxiques du Datura officinal.
On entend souvent que même les Doryphores, des coléoptères dont les larves raffolent des Solanacées (surtout des Pommes de Terre), s'intoxiqueraient en dévorant le Sauvageon... A vrai dire, cette légende potagère a peu de chance d'être fondée, le Datura officinal pouvant plus probablement servir de plante hôte (secondaire) à ces insectes «croque sorcières».
Bien sûr, il existe aussi des usages médicinaux (asthme, névralgies...) du Datura officinal, ancestraux ou contemporains (les feuilles de la plante sont inscrites à la liste A de la pharmacopée française). La dangerosité du Sauvageon les réserve toutefois au corps médical. Tous ces récits n'ont probablement rien de bien neuf pour vous: le Datura offcinal est une célébrité parmi les Sauvages, même s'il endosse le plus souvent un rôle de mauvaise graine. Mais il est une dernière histoire qui mérite d'être évoquée, celle des origines géographiques des Datura.

Feuilles alternes, glabres, ovales, au bord irrégulièrement denté et au sommet pointu du Datura officinal.
L'aire originelle des diverses espèces de Datura n'est pas très claire: Amérique pour les uns (Carl von Linné), Europe (Antonio Bertoloni) ou Asie (William Darlington) pour les autres... On considère aujourd’hui que le genre est issu du nouveau monde, et que le Datura officinal trouve ses origines autour du Mexique. L'introduction européenne de ce vieux Cabrón serait une des conséquences de la conquête de l'Amérique par Christophe Colomb, Saint Patron du brassage des populations végétales. Mais rien n'est complètement tranché: l'examen d'ouvrages andalous (Muhammad ibn Aslam Al-Ghafiqi) et d’iconographies indiennes laissent penser que quelques espèces du genre foulaient peut-être le sol du vieux continent bien avant les expéditions de Colomb (confère les travaux de R. Geeta)...
Dans la partie de la France qui me concerne (Poitou-Charentes), le Datura officinal est considéré comme un voyageur suspect, une invasive potentielle à surveiller (Liste hiérarchisée des plantes exotiques envahissantes d’Aquitaine, 2016), même si sa capacité d'envahissement reste pour l'heure modérée, concentrée autour des zones urbaines ou cultivées (c'est près des cultures qu'il est le plus gênant). L'installation d'un sorcier exotique en ville s'accompagne forcément de son lot d'inquiétudes et de suspicions!
Pour aller plus loin:
- Datura officinal sur Tela-botanica
- Datura officinal : identification assistée par ordinateur
 18/03/2020
18/03/2020

Érodium à feuilles de ciguë ou Bec de grue, Brenne (36)
Après nos aventures capillaires parmi les Géraniums, invitons d'autres membres de la famille Geraniaceae dans ces pages: les Érodiums, alias «Becs de grue». Pour rappel, les Géraniacées doivent leur nom au grec geranos, la grue. C'est pourtant à un autre oiseau que les Érodiums empruntent leur nom de genre: le héron, erodios en grec. Grue, héron, cigogne même (pour les Pélargoniums de nos balcons, pelargos en grec), les Geranciacées ne manquent pas de becs, à l'image de leurs longs fruits pointus.

Bec-de-grue musqué, Poitiers le Porteau

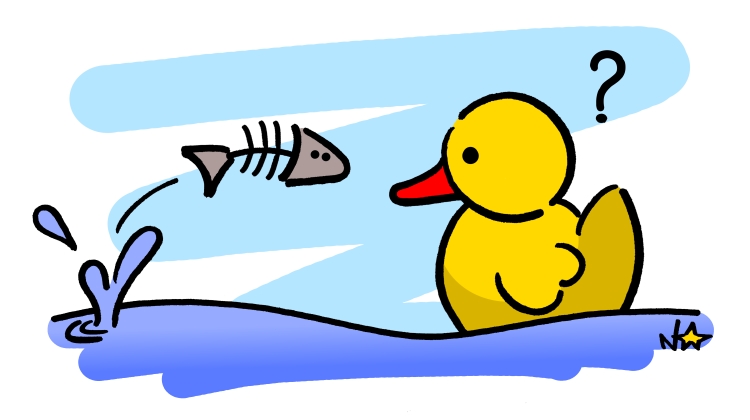


La féérie d'une praire à Érodium à feuilles de ciguë au printemps!
Le Bec-de-grue musqué est une annuelle un peu plus imposante que l’espèce précédente (10 à 60 centimètres de hauteur) qui fréquente les mêmes milieux. Sa répartition se concentre cependant dans l'ouest et le sud du pays. Ses premières fleurs peuvent apparaitre dès la fin du mois de février en Poitou, les dernières pouvant pointer jusqu'au début de l'automne. Dans son inventaire poitevin (Les plantes sauvages & leurs milieux en Poitou-Charentes, 2010), le botaniste Yves Baron le considère comme rare dans les terres. J'imagine que le sauvageon progresse efficacement vers l'intérieur du pays: on le croise sans peine aujourd'hui, du cœur de Poitiers jusqu'à l'est de la Vienne.

Feuilles collantes, composées imparipennées en des folioles dentées du Bec-de-grue musqué
A maturité, les folioles des feuilles de I'Érodium à feuilles de ciguë sont généralement incisées plus profondément que celles du Bec-de-grue musqué, mais sur un bout de trottoir, les deux espèces peuvent présenter des aspects chétifs assez trompeurs.
Parle moi des glandes...(Las Vegas Parano, Terry Gilliam)
Un critère peut cependant vous aider à trancher d'un coup de bec entre ces deux espèces. Ce détail intime exige le recours à une loupe de botaniste (si vous vous lancez dans l'aventure végétale, ça reste un excellent investissement d'une dizaine d'euros).

Bec-de-grue musqué : méricarpes à sillon infrafoveolaire très large, parsemé de glandes subsessiles ainsi que la fovéole (!!!) [extrait de Flora Gallica chez Biotope éditions, 2014]
J'en vois certains qui baillent aux corneilles devant autant de gros mots. Je me risque donc à un sous titrage plus personnel du cliché ci dessus, en français courant: attrapons notre Érodium par le bec, dépiautons le afin d'observer à la loupe l'intérieur des petites dépressions disposées à la base de l'arrête. Si vous notez la présence de petites glandes sphériques, c'est moschatum. (ces glandes ne sont pas présentes chez cicutarium). Attention, les glandes pouvant disparaitre sur les fruits matures, vérifiez plusieurs spécimens plutôt qu'un seul.

Fleurs du Bec-de-grue musqué: 5 pétales de tailles parfois légèrement différentes, un coquetterie subtile du genre.
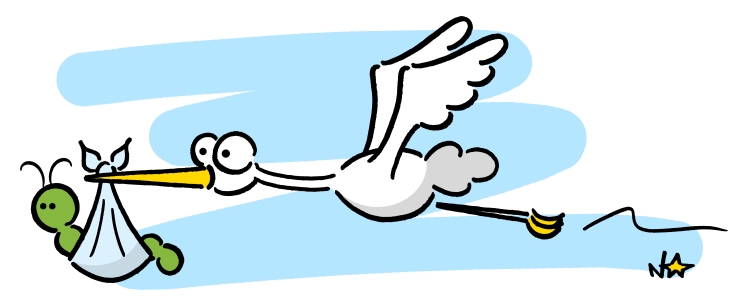

Pour aller plus loin:
- Erodium cicutarium sur Tela-botanica
- Erodium cicutarium : identification assistée par ordinateur
- Erodium moschatum sur Tela-botanica
- Erodium moschatum : identification assistée par ordinateur
- Taxonomie des Érodiums dans le bassin méditerranéen: un aperçu sur la richesse du genre!

L'incroyable fruit (akène) qui se prenait pour une perceuse! (Bec-de-grue musqué, Poitiers)
 05/09/2019
05/09/2019

Pourpier, place Charles de Gaulle à Poitiers
Portulaca oleracea (Pourpier ou Porcelane) appartient à la petite famille Portulacaceae (Portulacées) qui ne comprend qu'un seul genre en France dans la classification récente, le sien. Jusqu'à récemment, on ne comptait qu'une seule espèce de pourpier «sauvage» dans notre pays (il existe d'autres espèces cultivées dans les jardins): Portulaca oleracea. On en reconnait aujourd'hui sept. Malheureusement pour nous, celles-ci présentent une morphologie identiques à conditions égales et sont impossibles à différencier sur le terrain; à l’exception de leurs semences qui exigent un examen minutieux au microscope - doublé d'une lumière rasante - pour laisser entrevoir leurs différences. Voilà qui en éblouira certains tout en rasant d'autres!
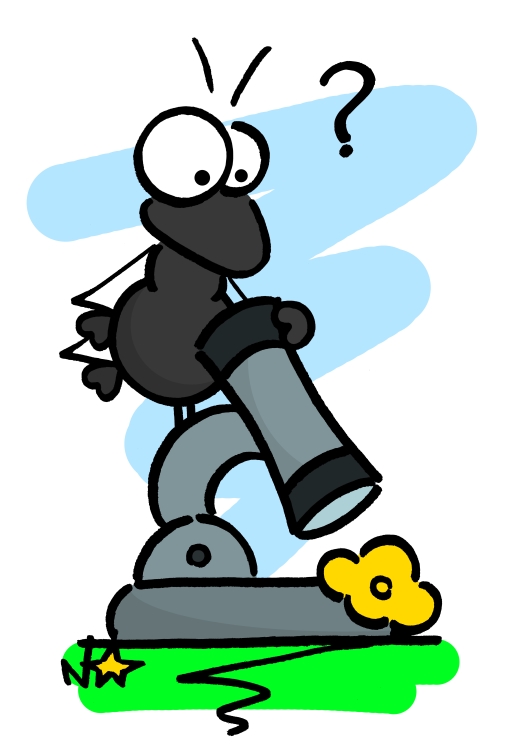
Les espèces les plus communes en France semblent être Portulaca trituberculata (hors méditerranée) et Portulaca granulatostellulata (méditerranée), devant Portulaca oleracea (source Flora Gallica). Pour ces raisons et en attendant des nouvelles fraîches de la planète botanique, les spécimens épinglés dans cet article renvoient aux Pourpiers «en général», sans chercher à préciser l’espèce.

Pourpier: qui a renversé son bol de noodle sur le trottoir?
Le Pourpier est une plante pionnière, annuelle qui pousse le plus souvent sur les sols misérables et chauds. Ses tiges charnues, rougeâtres et rameuses courent sur le macadam en été comme un bol de nouilles renversé sur le trottoir. A vrai dire, le sauvageon sait s’accommoder à d'autres situations, jusqu'à l'exact opposé tels que les jardins détrempés en hiver (avec certaines limites: il est gélif).
Le secret de sa résistance repose sur ses parties aériennes charnues, gorgées de suc, à l'image des plantes «grasses» comme les Crassulacées, des championnes de la survie en milieu hostile. A tel point que même déraciné, le Pourpier peut subsister jusqu'à maturité de ses graines. Tolérant la plupart des pollutions, le Pourpier est un bon candidat pour la phytoremédiation des sols souillés par les métaux lourds qu'il absorbe (chrome, cadmium et arsenic).

Fleurs discrètes et matinales du Pourpier: 4 à 6 pétales jaunes.
Sur des terres saines, le Pourpier (quelle que soit l’espèce, le microscope et la lumière rasante) constitue bien sûr une formidable salade sauvage. Le Pourpier est comestible, croquant sous la dent, mucilagineux, généralement mangé cru en salade, mais aussi parfois frit dans des recettes sucrées ou salées (omelettes, soupes...). Il est peu calorique, plus riche en vitamines A, B, C que la plupart des fruits de consommation courante, ainsi qu'en minéraux (potassium, magnésium et calcium). Son goût légèrement acidulé provient de la présence d'acide oxalique; c'est à noter, il convient peut-être de ne pas en faire un régime soutenu chez ceux qui sont sujets aux rhumatismes ou aux calculs rénaux.
On récolte avant floraison (après, il gagne un peu en amertume, ce qui n'enlève rien à son charme) ses feuilles spatulées, fermes et juteuses. Des feuilles en forme de patte de poulet: son nom viendrait de «poule pied»! A travers l'histoire, il est le Piedpoul, le Polpied, le Porpier, le Poupié ou le Pipou en en poitevin-saintongeais.


Fruits (capsules) du Pourpier: mon royaume pour un microscope!
C’est ça être une star: c’est avoir plus d’influence que la Bible et le Coran réunis.
(Les jolies choses, Gilles Paquet-Brenner)
Malgré ses qualités, la présence du Pourpier dans les assiettes a pourtant fluctué avec le temps, oscillant entre mode (il est la star du régime crétois) et désintérêt (il est surtout une mauvaise herbe, braves gens, brave gens...). Le sauvageon a même réussi a obtenir une citation biblique, quoique peu flatteuse. Dans le livre de Job (6:6), des traducteurs proposent le verset suivant: «Ce qui est fade se mange-t-il sans sel? Y a-t-il une saveur dans la bave de Pourpier?
».
Comme pour compenser cette ingratitude, d'autres légendes orientales racontent que Mahomet, s'étant blessé le pied, marcha sur du Pourpier: sa blessure guérit instantanément. Le Prophète bénit le sauvageon, désignant le Pourpier comme «un remède à 99 maux». Il n'en fallait pas moins pour faire du Sauvageon le «légume béni» de la médecine arabe au Moyen-âge.

Décor oriental en centre ville: une oasis de Pourpier sur un désert de macadam.
Jean-Baptiste de La Quintinie, jardinier et agronome en charge du Potager de Versailles, invita le Pourpier en tant que «salade de santé» à la table du Roi Soleil (Louis XIV). La médecine populaire accorde au Sauvageon des qualités émollientes, dépuratives et diurétiques. Appliqué directement sur la peau, son suc serait hydratant, adoucissant, pouvant calmer des légères irritations cutanées. Mâcher quelques feuilles calmerait l’inflammation des gencives ou de la gorge, ou plus simplement, couperait la soif. Officiellement, la pharmacopée française ne retient pas le Pourpier comme plante médicinale (Liste A), mais on comprend pourquoi ses parties aériennes, gorgées d'un suc rafraichissant, ont été considérées comme un doux pansement, en usage externe comme en usage interne. Bref, le Pourpier est surtout une excellente salade, l'occasion de se remémorer ce vieil adage: «Mange salade, jamais malade»!
Pour aller plus loin:
- Portulaca oleracea sur Tela-botanica
- Le Pourpier à travers l'histoire sur le blog Books of Dante
