 11/11/2020
11/11/2020

Datura officinal : l'épouvantable épouvantail!
Datura stramonium (Datura officinal ou Stramoine) appartient une famille de Sauvages un peu sorcières, celle des Solanaceae, de la Mandragore (Mandragora officinarum), de la Belladone (Atropa belladonna) ou de la Morelle noire (Solanum nigrum). Autant de plantes réputées pour leur toxicité ou leur pouvoirs psychotropes, due aux alcaloïdes qu'elles synthétisent. Mais de la sorcellerie à la ratatouille, il n'y a qu'un tout petit chaudron: ce clan est aussi celui de nos chères Tomates, de la Pomme de terre, du Poivron ou de l’Aubergine.

Floraison tardive (juillet à octobre) du Datura officinal: la «Trompette de la mort».
A un moment, le sorcier s’est mis à nous menacer avec ses parties génitales.
(Kaamelott, Alexandre Astier)
Sorcier hérissé chez les Solanacées, le Datura officinal est précédé par son aura sulfureuse. En témoignent ses multiples surnoms: il est l'Herbe aux fous, l'Herbe du diable, l'Herbe aux sorcières, la Pomme poison ou la Trompette de la mort... Datura dérive de l'arabe tatorâh, où l'on retrouve la racine du mot tat, «piquer» : son surnom le plus célèbre est sans doute la Pomme épineuse, à cause de ses fruits gros comme des noix (des capsules) couverts de robustes épines.
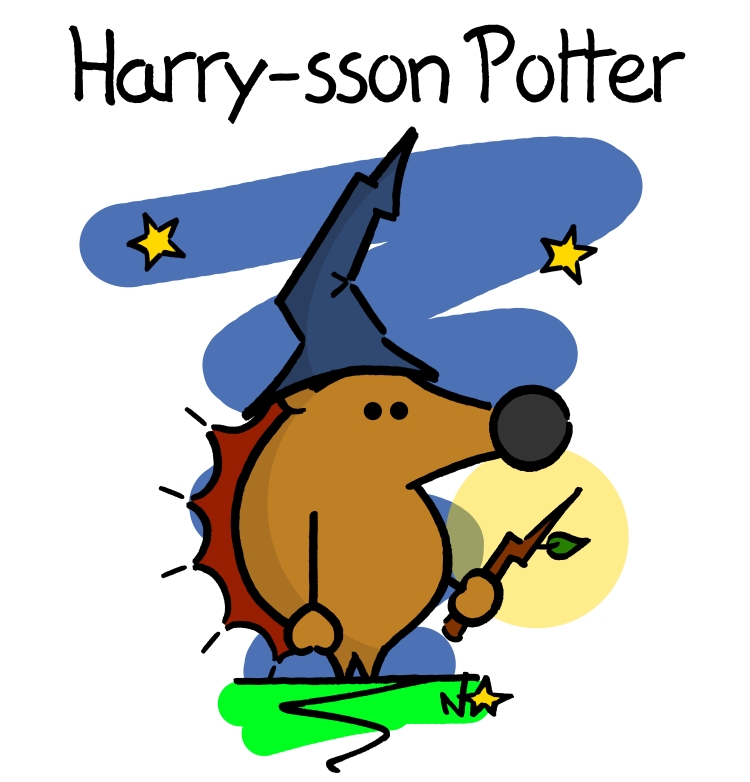

Datura officinal ou Pomme épineuse, Île de Ré (17)
Le Datura est une annuelle robuste qui pousse dans les champs cultivés, les friches, les décombres... Il aime les sols fraîchement retournés, de préférence frais et riches en nitrates (issus des amendements et/ou de la pollution). C'est une adventice bien connue des cultures maraichères, mal venue à cause de sa toxicité, car pouvant «contaminer» certaines récoltes (farines, conserves, maïs ensilé pour le bétail...).

Datura officinal: 40 centimètres à 1 mètre de hauteur pour ce sorcier qui ne manque ni de force ni d'élégance.
L'évocation de la toxicité du Datura n'étonnera personne. Il n'est gère difficile de dénicher ici et là des citations qui évoquent les usages anciens du Sauvageon dans des rites magiques ou chamaniques: fumigation hallucinogène (en fait délirogène) sur le continent américain, charme magique en Afrique du nord (philtre d'amour) ou en Inde (breuvage abrutissant), potion «zombi» dans les rites vaudous en Haïti...! On retiendra surtout que la dangerosité du Datura est avérée, dans toutes les parties de la plante, et que sa consommation a généralement pour conséquence une hospitalisation. On ne joue pas plus avec le Datura qu'avec le feu.
Et puisqu'on parle de feu: ne brûlez pas les pieds arrachés, la fumée alors provoquée étant toxique si inhalée. L'histoire de France se souvient d'ailleurs d'un gang de vauriens connus sous le nom d'endormeurs (18ème siècle), qui offraient à leur victime un tabac coupé aux semences de Datura, profitant ensuite de leur délire ou de leur assoupissement pour les détrousser!

Semences toxiques du Datura officinal.
On entend souvent que même les Doryphores, des coléoptères dont les larves raffolent des Solanacées (surtout des Pommes de Terre), s'intoxiqueraient en dévorant le Sauvageon... A vrai dire, cette légende potagère a peu de chance d'être fondée, le Datura officinal pouvant plus probablement servir de plante hôte (secondaire) à ces insectes «croque sorcières».
Bien sûr, il existe aussi des usages médicinaux (asthme, névralgies...) du Datura officinal, ancestraux ou contemporains (les feuilles de la plante sont inscrites à la liste A de la pharmacopée française). La dangerosité du Sauvageon les réserve toutefois au corps médical. Tous ces récits n'ont probablement rien de bien neuf pour vous: le Datura offcinal est une célébrité parmi les Sauvages, même s'il endosse le plus souvent un rôle de mauvaise graine. Mais il est une dernière histoire qui mérite d'être évoquée, celle des origines géographiques des Datura.

Feuilles alternes, glabres, ovales, au bord irrégulièrement denté et au sommet pointu du Datura officinal.
L'aire originelle des diverses espèces de Datura n'est pas très claire: Amérique pour les uns (Carl von Linné), Europe (Antonio Bertoloni) ou Asie (William Darlington) pour les autres... On considère aujourd’hui que le genre est issu du nouveau monde, et que le Datura officinal trouve ses origines autour du Mexique. L'introduction européenne de ce vieux Cabrón serait une des conséquences de la conquête de l'Amérique par Christophe Colomb, Saint Patron du brassage des populations végétales. Mais rien n'est complètement tranché: l'examen d'ouvrages andalous (Muhammad ibn Aslam Al-Ghafiqi) et d’iconographies indiennes laissent penser que quelques espèces du genre foulaient peut-être le sol du vieux continent bien avant les expéditions de Colomb (confère les travaux de R. Geeta)...
Dans la partie de la France qui me concerne (Poitou-Charentes), le Datura officinal est considéré comme un voyageur suspect, une invasive potentielle à surveiller (Liste hiérarchisée des plantes exotiques envahissantes d’Aquitaine, 2016), même si sa capacité d'envahissement reste pour l'heure modérée, concentrée autour des zones urbaines ou cultivées (c'est près des cultures qu'il est le plus gênant). L'installation d'un sorcier exotique en ville s'accompagne forcément de son lot d'inquiétudes et de suspicions!
Pour aller plus loin:
- Datura officinal sur Tela-botanica
- Datura officinal : identification assistée par ordinateur
 20/09/2020
20/09/2020

Sariette commune, Poitiers quartier Chilvert
Clinopodium vulgare (Sariette commune ou Clinopode commun) appartient aux Lamiaceae, la famille des Sauvages aromatiques à fleurs en forme de gueule ouverte (voir notre article complet sur le sujet). L'arôme n'est pourtant pas le point fort de la Sariette commune qui est peu odorante, voire pas du tout. Son surnom de Grand Basilic est donc un poil fanfaron. Hors floraison, la subtilité ou l'absence de son parfum nous aidera éventuellement à la différencier de l'Origan commun, aux feuilles parfumées ressemblantes.

Feuilles lancéolées ou ovales, densément poilues de la Sariette commune (les feuilles de l'Origan ne sont couvertes que de quelques poils éparses).
J'ai envie d'être heureux, de dormir dans un vrai lit, d'avoir des racines...(Léon, Luc Besson)
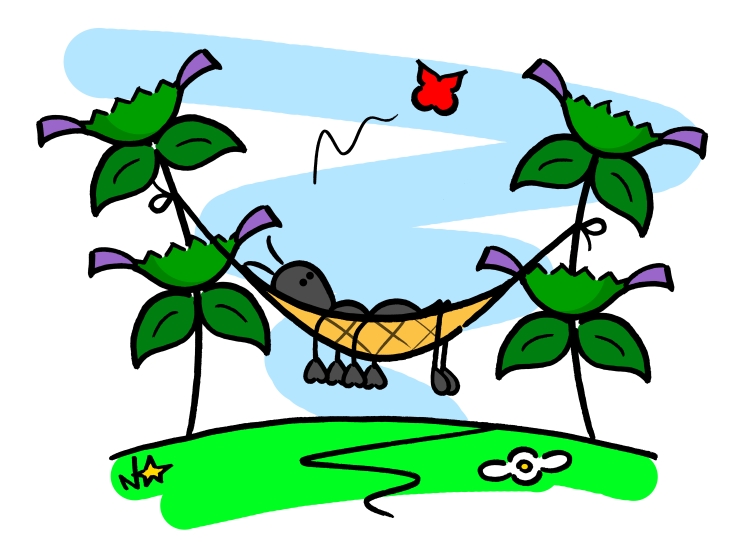

Malgré ses allures de couchette, les ancien accordaient à la Sariette commune des vertus toniques. Elle est comestible, mais ses feuilles relativement coriaces et son manque de saveur n'en font pas un met de premier choix. En tout cas en ce qui nous concerne: les butineurs manquent rarement le festin de ses fleurs mellifères à la fin de l'été. Tinctoriale, la Sariette confiées à des mains habiles (pas les miennes) permet d'obtenir une teinture jaune.

Fleurs purpurines de la Sariette commune réunies en gros de verticilles axillaires et terminaux compacts.
La Sariette commune est une vivace tout-terrain: ses colonies sont capable de s'installer dans tous les milieux, jusqu'aux zones fortement perturbés par l'homme, avec une léger penchant pour les lisières forestières ou les bois parsemés. Ses tiges et ses calices ciliés restent érigés jusqu'au début de l'hiver, les fruits étant dispersés par le vent ou par les animaux de passage.

Sariette commune de Décembre, Poitiers bords de Boivre
Le genre Clinopodium recense six espèces sur le territoire français. Impossible de se quitter sans mentionner un autre incontournable du genre, dont le parfum ne laissera personne indifférent:


Faux! Faux! Complètement faux! J’ai envie de te dire menteur!
(Brice de nice, James Huth)
Si le Calament glanduleux est une «fausse» menthe, il a parfois été surnommé Fausse Marjolaine ou Faux Nepeta... Bref, difficile pour le Sauvageon de se défaire de l'aura de faussaire qu'on lui prête. Il n'a pourtant rien à envier à ses sœurs Lamiacées les plus renommées.
Utilisé comme condiment dans la cuisine corse et italienne, le Calament glanduleux est commercialisé sous le nom de «népita» («nipitella» en Italie) et parfume les légumes, les poissons ou les viandes. On lui prête des vertus digestives (particulièrement contre les problèmes d'aérophagie). Au moyen âge, on le prescrivait contre le hoquet. Quant à la fraicheur de son parfum: un randonneur du sud de la France m'a confié un jour qu'il lui arrivait d'utiliser le Sauvageon comme dentifrice de fortune... En se frottant la plante sur les dents!


Clinopodium nepeta subsp. sylvaticum, une autre sous espèce. Surnommé le Calament des bois, Celui-ci préfère les bois et les lisières forestières et dresse des fleurs plus grandes que l’espèce type, aux couleurs généralement mieux marquées.
Pour aller plus loin:
- Clinopodium vulgare sur Tela-botanica
- Clinopodium vulgare: identification assistée par ordinateur
- Clinopodium nepeta sur Tela-botanica

Clinopodium acinos, alias le «Petit Basilic», un autre «Clinopode» des pelouses sèches.
 05/07/2020
05/07/2020

Petite Primprenelle: la mignonitude au jardin.
Poterium sanguisorba (Pimprenelle à fruits réticulés ou Petite Pimprenelle) appartient à la famille Rosaceae, où elle évolue entre les Roses et les Ronces, mais aussi les célèbres Cerisiers, Pommiers, Poiriers et autres géants; une famille assurément généreuse pour l'homme. Comme bon nombre de ses sœurs de sève (ce n'est pas une règle absolue), la Petite Pimprenelle présente des feuilles alternes, composées et nettement stipulées.

Feuilles de la Petite Pimprenelle, composées imparipennées en 9 à 25 folioles dentées.
Les fleurs des Rosacées choisissent souvent d'arborer cinq pétales et cinq sépales, mais la Petite Pimprenelle joue la carte de l'originalité: ses fleurs regroupées en tête sont dénuées de pétales. Strictement mâles, strictement femelles ou hermaphrodites, elles n'en sont pas moins belles! Les fleurs femelles dominent au sommet (elles ressemblent a de minuscules anémones de mer rouges), les fleurs mâles pendouillent en bas, quelques fleurs hermaphrodites (aux étamines jaunes et courtes) assurent parfois la frontière entre dames et messieurs. Le tout formant un brushing rastafari plus flashy que le chignon de Lady Gaga un soir de bal.

Inflorescence de la Petite Pimprenelle : depuis leur calice à quatre sépales verts bordés de blanc, se dressent des stigmates rouges en haut (fleurs femelles). De longues étamines pendent en bas (fleurs mâles).
Alors que la plupart des Rosacées dépendent des insectes pour assurer leur pollinisation, la Petite Pimprenelle compte surtout sur le vent qui caresse ses cheveux (tous les insectes ne la boudent pas pour autant). Vous l'aurez compris : en séparant ainsi ses fleurs mâles et ses fleurs femelles, la Sauvage favorise la pollinisation croisée. D'autant plus que fleurs mâles et femelles n'arrivent pas forcément à maturité en même temps sur un même pied.

Love story de la Petite Pimprenelle: Monsieur au dessus, Madame en dessous, ne manque plus que le souffle du vent pour que ça matche!
La Petite Pimprenelle est une vivace commune qui pousse dans les prairies sèches, au bord des chemins ou dans les rocailles. Elle adapte sa prestance à la richesse de son milieu, se dressant entre 20 et 60 centimètres de hauteur entre mai et septembre. A titre de comparaison, sa grande sœur, la Grande Primprenelle (Sanguisorba officinalis), peut dépasser le mètre et se rencontre dans les milieux humides, avec une répartition très confidentielle en plaine. La Grande Pimprenelle est une espèce rare et déterminante pour tout le Poitou (elle est parfois introduite volontairement dans les jardins d'ornement).
En latin, Sanguisorba pourrait se traduire par «absorber le sang». Ce sont les parties souterraines de la Grande Pimprenelle qui sont inscrites à la liste la liste A de la Pharmacopée française. On leur reconnait des propriétés hémostatique, dues aux tanins concentrés dans les racines.
La Petite Pimprenelle ravira toutefois les amateurs de salade ou de pesto sauvages: ses feuilles fraiches, comestibles, présentent un léger goût de concombre. On peut éventuellement les laisser infuser à froid toute une nuit (une infusion normale, ou un séchage, risquerait d’anéantir sa saveur délicate) pour obtenir une boisson rafraîchissante et astringente, ses feuilles étant assez tanniques.

Petite Pimprenelle: l'envol d'une fée au jardin!
Tante Flora, Tante Pâquerette Tante Pimprenelle!
(La Belle au bois dormant, Walt Disney)
Surtout, son seul (pré)nom invoque à table ou au jardin une touche indéniable de poésie. Les plus anciens se souviendront de Nounours et de Pimprenelle, la poupée aux cheveux de laine, héroïne de la série Bonne nuit les petits. D'autre penseront à l'une des trois fées (celle qui porte une robe bleue) dans la Belle au bois dormant. Le calendrier républicain lui rend hommage vers le début du mois de mai, le 17ème jour du mois de Floréal. A l'heure où des prénoms comme Rose, Cerise ou Prune (d'autres Rosacées) ont le vent en poupe, Pimprenelle reste un prénom trop rare, fêté le jour de Sainte Fleur, le 5 octobre (ça ne s'invente pas). Alors si ce prénom est le votre, permettez moi de vous féliciter - considérez-vous comme une espèce protégée - et de vous dédicacer ce modeste article!


Orfèvrerie des fruits de la Petite Pimprenelle (akènes tétragones).


Pour aller plus loin:
- Poterium sanguisorba: identification assistée par ordinateur
