 15/11/2019
15/11/2019

Colonie de Grande Consoude, Poitiers bords de Clain
Symphytum officinale (Grande Consoude) appartient à la famille Boraginaceae, aux côtés de la Bourrache officinale (Borrago officinalis), de la Vipérine commune (Echium vulgare) ou des Myosotis. Les membres de ce clan présentent souvent des inflorescences caractéristiques en «queue de scorpion» (cyme scorpioïde) et sont souvent couverts de poils raides: les Boraginacées doivent leur nom au latin burra, la «burre», une étoffe en laine rêche et grossière qui habillait autrefois les moines. Ainsi, les feuilles et les tiges anguleuses de la Grande Consoude sont vêtues d'une moumoute de poils hérissés non piquants.

Inflorescence en «queue de scorpion» de la Grande Consoude: des fleurs à 5 sépales et 5 pétales soudés en un tube.
La Grande Consoude est une vivace imposante (jusqu'à 120 centimètres de hauteur) qui s'installe de préférence dans les prés ou les boisements humides, à proximité de l'eau (rivières, étangs, marais...). Ses fleurs affichent des couleurs variées suivant les colonies (blanches, jaunes, roses, purpurines...). De plus, comme souvent chez les Boraginacées (voir notre article sur les Myosotis), la coloration des fleurs peut varier en fonction de leur maturité, indiquant aux insectes quelle corolle il convient de visiter en priorité.
Yo-ho, quel bonheur d’être un voleur! On vide les coffres et les pichets!
(Peter Pan, Walt Disney)
Les fleurs de la Grande Consoude présentent une caractéristique peu banale: les organes sexuels (pistil et étamines) bénéficient d'une double protection, celle du tube formé par les pétales, mais aussi celle de cinq écailles qui les recouvrent à l'intérieur de la corolle. Autant dire que cette forteresse met à mal certains butineurs invités par les couleurs et le parfum de la Sauvage (imperceptible pour l'homme). Les insectes munis d'une longue trompe tirent leur épingle du jeu, mais ce sont le plus souvent les bourdons qui profitent du trésor mellifère: ceux-ci peuvent forcer le passage, ou mieux, percer directement la base de la corolle grâce à leurs mandibules pour atteindre le précieux nectar.

A l'intérieur du coffre-fort des fleurs de la Grande Consoude, 5 écailles forment un cône protecteur autour des organes sexuels.
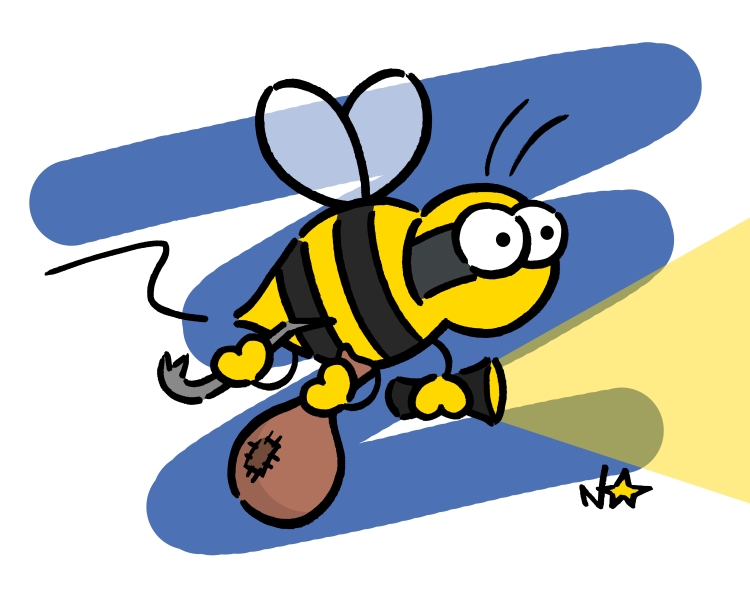
Une fois la corolle fracturée depuis l’extérieur par les bourdons, d'autres insectes profitent de l'ouverture. C'est là un véritable braquage végétal, puisque la Grande Consoude est délestée de son butin sans que les insectes ne viennent se frotter à ses organes sexuels. La Grande Consoude n'est donc pas une bonne reproductrice sexuée, la faute au blindage interne de ses fleurs! Heureusement, elle compense par une capacité de reproduction végétative très efficace qui lui permet de coloniser rapidement les espaces propices (sol profond, riche et humide). Championne du bouturage, elle peut aisément repartir depuis le moindre fragment de racine.

Bourdon fracturant une corolle de Consoude par l’extérieur: au voleur!
De par sa biomasse imposante et sa vigueur, la Grande Consoude a été considérée comme une fourragère généreuse, apte à nourrir veau, vache, cochon, couvée... Autrefois, l'homme consommait parfois ses racines (pelées et cuites à l'eau) et surtout ses feuilles au goût légèrement iodé qui peuvent faire office de «filet de poisson végétal» (pané, testé et approuvé). Aujourd'hui, on considère qu'une consommation exagérée ou régulière de la Sauvage serait dangereuse pour l'homme, à cause de la présence d’alcaloïdes hépatotoxiques, particulièrement dans ses racines. La Grande Consoude rejoint donc la liste des aliments sympathiques-mais-dont-il-ne-faut-pas-abuser (quelque part entre les chips Springles et les fraises Tagada?).

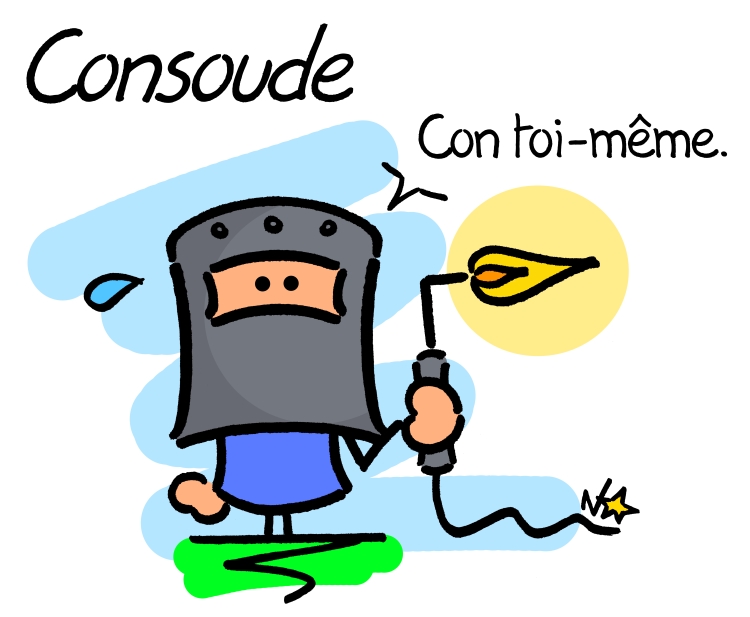


Si la Grande Ortie manque rarement dans les jardins particuliers, la présence de la Grande Consoude est plus anecdotique. Il convient donc de l'importer si on veut la garder à portée de ciseaux. Il suffit pour l'inviter de prélever un morceau de tige et un bout de racine, puis de la replanter sur un sol profond. Mais en terrain propice, la belle peut se montrer envahissante et difficile à déloger une fois en place. C'est pourquoi on préfère généralement à la Grande Consoude des spécimens sélectionnés pour leur générosité, leur robustesse et leur stérilité (ils ne se ressèment pas). La variété la plus célèbre dans les potagers se nomme Bocking 14, un cultivar stérile de l'hybride fertile Symphytum x uplandicum, croisement entre Symphytum officinale, la Grande Consoude, et Symphytum asperum, la Consoude Hérissée... Dans la nature comme en horticulture, les métissages font lois!

Symphytum x uplandicum, un hybride qui se naturalise ici et là. Polymorphe, il mélange les caractéristiques de ses deux parents: feuilles peu décurrentes (feuilles longuement décurrentes chez l'Officinale / non décurrentes chez l'Hérissée), poils un peu piquants (non piquants chez l'Officinale / très piquants chez l'Hérissée).
Pour aller plus loin:
- Symphytum officinale sur Tela-botanica
- Symphytum officinale: identification assistée par ordinateur
- La Consoude est-elle toxique? sur le site passeportsante.net
Lecture recommandée:
- La Consoude, trésor du jardin de Bernard Bertrand (éditions de Terran)

Consoude tubéreuse (Symphytum tuberosum): une autre espèce indigène discrète (20 à 60 centimètres de hauteur) à la tige ronde et aux fleurs toujours jaunes claires. Sa répartition se limite à la moitié sud de la France.
 15/08/2019
15/08/2019

Garance voyageuse rougissante en hiver
Rubia peregrina (Garance voyageuse) appartient au clan Rubiaceae, de même que les célèbres Gaillets (Galium spp). Les membres de cette famille présentent le plus souvent des tiges carrées, ainsi que des feuilles verticillées, c'est à dire disposées en couronne ou en étoile autour de la tige. Leurs fleurs sont généralement discrètes, à quatre ou cinq pétales. Celles de la Garance voyageuse pointent en été (entre juin et aout) cinq pétales jaunes pâles terminés en pointe. Elles sont réunies en cymes généreuses à l’aisselle des feuilles et à l’extrémité des rameaux, compensant leur discrétion par le feu d'artifice de leur assemblée.

Fleurs de la Garance voyageuse en été: "Oh la belle verte!"
Peignons ces roses en rouge, du plus éclatant des rouges, il faut les peindre coûte que coûte sans en perdre une goutte!
(Alice au pays des merveilles, Walt Disney)
La Garance voyageuse est une vivace forestière qui aime la lumière et les sols secs. On la croise le long des lisières des forêts sèches, ou dans les bois clairs. Ses feuilles coriaces, brillantes et persistantes rougissent à l'approche de l'hiver. Le genre Rubia emprunte d'ailleurs son nom au latin ruber, rouge: les Garances sont des célèbres plantes tinctoriales. La Garance des teinturiers (Rubia tinctorum) a été largement cultivée, depuis la Grèce antique, son rhizome permettant d'obtenir une teinture rouge pur. La Garance voyageuse a parfois été utilisée en ce sens, mais sans connaitre d’industrialisation, ses racines plus minces offrant un colorant moins vif, rouge-orangé. Vous en conviendrez, il est difficile de se passer d'une touche de (nez) rouge dans la vie... Merci les Garances!

* Pas très drôle / Très drôle

Des feuilles verticillées (2 à 5), ovales-lancéolées, persistantes, coriaces et surtout crochues: accroche toi à la Garance voyageuse, j'enlève l'échelle!
- Il serait possible de me coller à vous pendant quelques jours?
- Ah mais toute la vie si vous voulez!
(Taxi 3, Gérard Krawczyk)
Si les feuilles de certains Gaillets (Gaillet gratteron) sont réputées pour leur pouvoir agrippant, la Garance voyageuse n'a pas à rougir de ce côté : les siennes sont bardées d'aiguillons qui accrochent les fourrures des animaux ou les vêtements des promeneurs. La belle est capable de s’agripper au point de vous griffer superficiellement la peau. Ses crochets lui permettent d'ériger sa longue tige (ligneuse à la base, jusqu'à 2 mètres de longueur) vers la lumière en prenant appui sur d'autres végétaux, sur une clôture ou sur un grillage; à l'occasion, ils lui permettent aussi de faire un bout de route grâce à votre bas de pantalon, dispersant peut-être quelques fruits au passage.

Baies de la Garance voyageuse en automne: "Hep taxi!"
Ses baies lisses et noires à maturité (légèrement toxiques et laxatives pour l'homme) sont surtout destinées à être picorées par les animaux, à commencer par les rouges-gorges. Des oiseaux rouges, forcément, qui propagent les fruits qu'ils consomment en les rejetant via leurs fientes. La Garance voyageuse est une habituée du «taxi crotte» (endozoochorie), empruntant les intestins des volatiles, des chèvres ou des moutons pour parvenir à ses fins. Pourtant, malgré son goût du voyage qu'elle porte jusque dans son nom (peregrina est «l'étrangère» en latin), la Garance voyageuse semble absente dans le nord et le nord-est de la France.

On raconte que le lait, l'urine, la laine ou même le bec et les os des animaux qui consomment régulièrement la Garance voyageuse se teintent de rouge... Je ne saurais dire si c'est vrai, mais les jeunes feuilles tendres de la Garance voyageuse sont parfois grignotées par le Crache sang (Timarcha tenebricosa). Ce gros coléoptère aux élytres soudées (il est incapable de voler) se nourrit des Gaillets et apparentés. Dérangé ou menacé, il excrète des goutes d'hémolymphe rouge-orangé, une «encre» sanguine au goût peu appétant qui le protège de ses prédateurs. Bref, lui aussi fait dans le vermillon, surtout quand il voit rouge!

Crache-sang sur Garance voyageuse, bois de la Brie à Vivonne (86)
En guise de conclusion, impossible de faire l'impasse sur une célèbre revue qui emprunte le nom de notre Sauvage: depuis 1988, La Garance voyageuse livre directement dans la boite aux lettres de ses abonnés, saisons après saisons, des articles rigoureux, drôles, dessinés, forcément accrocheurs et attachants (Garance oblige) autour du monde végétal. Avis aux apprentis botanistes!
Pour aller plus loin:
- Rubia peregrina sur Tela-botanica
- Numéro de découverte de la revue La Garance Voyageuse
 28/06/2019
28/06/2019

Morelle Noire, Villeurbanne (69)
Solanum nigrum (Morelle noire) appartient au clan Solanaceae, aux côtés des pommes de terre, des tomates, des aubergines, mais aussi des fantastiques Mandragore (Mandragora officinarum), Datura officinal (Datura stramonium) et Belladone (Atropa belladonna); des plantes connues pour leur toxicité ou leur pouvoirs psychotropes, due aux alcaloïdes qu'elles synthétisent pour se protéger des assauts des herbivores.

- Comment vous trouvez le poulet?
- Mort.
(Après vous, Pierre Salvadori)
La Morelle noire n'est pas en reste: les baies noires qu'elle produit sont toxiques avant maturité. La solanine contenue dans ses fruits - substance que l'on retrouve aussi dans les parties vertes des pommes de terre ou les feuilles des pieds de tomates - est dangereuse pour l'homme comme pour les animaux domestiques. Ce qui vaut à la Morelle noire des surnoms poétiques, tels que Tue-chien ou Crève-poule en poitevin-saintongeais!

Baies mûres de la Morelle noire, Louhossoa (64)





Depuis tout petit, je suis coupable: j'ai toujours été coupable.(Rien à déclarer, Dany Boon)
En Europe, la famille Solanaceae est intimement liée à l'histoire de la sorcellerie. Mandragore, Belladone, Datura, Jusquiane: autant de plantes dangereuses, voir mortelles pour celui qui les utilise à mauvais escient, mais qui peuvent devenir de puissants psychotropes entre des mains initiées. On raconte que les sorcières fabriquaient un onguent avec la Morelle noire, dont elles se recouvraient le corps pour aller au sabbat en songe (assemblée nocturne de magiciennes)! Pour certains auteurs, Solanum viendrait d'ailleurs du latin solari, «je console», à cause de ses propriétés narcotiques et calmante (ses parties aériennes et ses fruits sont inscrits à la liste A des plantes médicinales de la pharmacopée française). La Morelle noire aurait également servi à confectionner une encre qui permettait de communiquer avec les défunts, ou des encens (aux fumées toxiques) pour faire offrande aux divinités crépusculaires... Brrrr!

Bref, la Morelle noire s'est taillé à travers l’histoire une aura sulfureuse et peu catholique. Pas étonnant qu'elle reste aujourd'hui cantonnée au rayon des «mauvaises herbes» sous nos latitudes et que ses potentialités soient le plus souvent ignorées. Au village, sans prétentions, la Morelle a-t-elle mauvaise réputation?

Larve de Doryphore: aux couleurs d'Halloween!
Peut-être que sa rédemption viendra des potagers où elle est parfois vue d'un bon œil par les jardiniers: les Doryphores (Leptinotarsa decemlineata, des grands amateurs de Solanacées) bouloteraient à l'occasion notre ex-magicienne plutôt que les rangs de patates (ou plus rarement de tomates ou d'aubergines). Après l'arrachage et la récolte des pommes de terre, attention à ne pas tolérer plus longtemps la (les) Morelle(s) autour des potagers: la Sauvage pourrait devenir un refuge de premier choix pour ces ravageurs croque-sorcières!

En guise de conclusion, deux incontournables du genre au potager: Solanum tuberosum, alias la Pomme de terre...

... Et Solanum lycopersicum, alias la Tomate cultivée. De la sorcellerie à la ratatouille, il n'y a qu'un tout petit chaudron!
Pour aller plus loin:
- Solanum nigrum sur Tela-botanica
- Solanum nigrum : identification assistée par ordinateur
- Solanum nigrum, un article de fond sur le blog de J.F.Dumas
Lecture recommandée:
