
Sariette commune, Poitiers quartier Chilvert
Clinopodium vulgare (Sariette commune ou Clinopode commun) appartient aux Lamiaceae, la famille des Sauvages aromatiques à fleurs en forme de gueule ouverte (voir notre article complet sur le sujet). L'arôme n'est pourtant pas le point fort de la Sariette commune qui est peu odorante, voire pas du tout. Son surnom de Grand Basilic est donc un poil fanfaron. Hors floraison, la subtilité ou l'absence de son parfum nous aidera éventuellement à la différencier de l'Origan commun, aux feuilles parfumées ressemblantes.

Feuilles lancéolées ou ovales, densément poilues de la Sariette commune (les feuilles de l'Origan ne sont couvertes que de quelques poils éparses).
J'ai envie d'être heureux, de dormir dans un vrai lit, d'avoir des racines...
(Léon, Luc Besson)
Clinopodium vulgare tire son nom du grec clino, le «lit» et podos, le «pied». C'est le père fondateur de la botanique Dioscoride qui cru reconnaître dans le silhouette de la Sauvage le profil de ses pieds de lit. En ces temps où les grandes enseignes de distribution de meubles suédois n'existaient pas, le mobilier pouvait déjà prendre des allures surprenantes. La Sariette nous permet peut-être d'imaginer à quoi ressemblait la chambre à coucher du médecin-botaniste!
Sariette commune : un Citron (Gonepteryx rhamni) photographié au pied du lit.
Malgré ses allures de couchette, les ancien accordaient à la Sariette commune des vertus toniques. Elle est comestible, mais ses feuilles relativement coriaces et son manque de saveur n'en font pas un met de premier choix. En tout cas en ce qui nous concerne: les butineurs manquent rarement le festin de ses fleurs mellifères à la fin de l'été. Tinctoriale, la Sariette confiées à des mains habiles (pas les miennes) permet d'obtenir une teinture jaune.

Fleurs purpurines de la Sariette commune réunies en gros de verticilles axillaires et terminaux compacts.
La Sariette commune est une vivace tout-terrain: ses colonies sont capable de s'installer dans tous les milieux, jusqu'aux zones fortement perturbés par l'homme, avec une léger penchant pour les lisières forestières ou les bois parsemés. Ses tiges et ses calices ciliés restent érigés jusqu'au début de l'hiver, les fruits étant dispersés par le vent ou par les animaux de passage.

Sariette commune de Décembre, Poitiers bords de Boivre
Le genre Clinopodium recense six espèces sur le territoire français. Impossible de se quitter sans mentionner un autre incontournable du genre, dont le parfum ne laissera personne indifférent:
Calament glanduleux, Poitiers sous Blossac
Clinopodium nepeta (Calament glanduleux) est une vivace rameuse. Ses feuilles dégagent, tout au contraire de la Sariette commune, une puissante odeur mentholée et camphrée, unique en son genre. Le Calament (de son ancien nom Calamintha) est littéralement la «belle menthe» en grec (calê minthê).
Botaniquement parlant, le Calament glanduleux a de quoi dérouter... On lui reconnait plusieurs sous-espèces, dont l'habitat et l'apparence varient considérablement. Sauf mention contraire, les photos de la seconde partie de cet article présentent l’espèce type,
Clinopodium nepeta subsp. nepeta, qui affectionne les rocailles ou les vieux murs exposés au soleil, assez commune dans le sud de la France mais plus rare ailleurs. Ses feuilles sont petites, le plus souvent vaguement dentées, brièvement
pétiolées. Ses fleurs très pâles ont une légère teinte lilas violacé.
Fleurs mauve très pâle du Calament glanduleux: corolle en tube presque droit, étamines rangées sous la lèvre supérieure, lèvre inférieure trilobée. Faux! Faux! Complètement faux! J’ai envie de te dire menteur!
(Brice de nice, James Huth)
Si le Calament glanduleux est une «fausse» menthe, il a parfois été surnommé Fausse Marjolaine ou Faux Nepeta... Bref, difficile pour le Sauvageon de se défaire de l'aura de faussaire qu'on lui prête. Il n'a pourtant rien à envier à ses sœurs Lamiacées les plus renommées.
Utilisé comme condiment dans la cuisine corse et italienne, le Calament glanduleux est commercialisé sous le nom de «népita» («nipitella» en Italie) et parfume les légumes, les poissons ou les viandes. On lui prête des vertus digestives (particulièrement contre les problèmes d'aérophagie). Au moyen âge, on le prescrivait contre le hoquet. Quant à la fraicheur de son parfum: un randonneur du sud de la France m'a confié un jour qu'il lui arrivait d'utiliser le Sauvageon comme dentifrice de fortune... En se frottant la plante sur les dents!


Clinopodium nepeta subsp. sylvaticum, une autre sous espèce. Surnommé le Calament des bois, Celui-ci préfère les bois et les lisières forestières et dresse des fleurs plus grandes que l’espèce type, aux couleurs généralement mieux marquées.
Pour aller plus loin:
- Clinopodium vulgare sur Tela-botanica
- Clinopodium vulgare: identification assistée par ordinateur
- Clinopodium nepeta sur Tela-botanica

Clinopodium acinos, alias le «Petit Basilic», un autre «Clinopode» des pelouses sèches.

Halicte des scabieuses (Halictus scabiosae) butinant une Scabieuse? Non, un Dahlia!
Dans nos précédents articles consacrés aux insectes pollinisateurs, nous avons pu constater un progrès dans l’outillage des insectes pour le butinage des fleurs: nous sommes passés des coléoptères (lourdauds et parfois quelque peu barbares avec les fleurs) aux diptères, puis aux lépidoptères (plus délicats et sophistiqués envers les Sauvages). Au final, nous nous sommes peut-être posé une question: tout ce butinage permet-il une pollinisation efficace? En d’autres termes, scarabées, mouches et papillons sont-ils les insectes les mieux équipés pour polliniser les plantes? La réponse est négative: les champions, en la matière, ce sont les hyménoptères!
Cela dit, il faut nuancer notre propos. En effet, certains hyménoptères comme les guêpes, les tenthrèdes ou les fourmis, s’ils se comportent comme des insectes floricoles, s’apparentent plus à des pollinisateurs relativement «moyens». Non, la véritable pollinisation, la pollinisation scientifique, nous vient d’un insecte prolétaire, d’une petite tâcheronne obsédée par les fleurs: l’abeille.
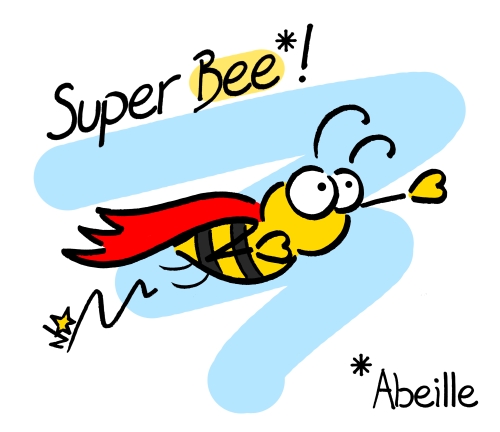
D’où lui vient cette passion florale? C’est que par rapport aux autres pollinisateurs attirés par le nectar, voire seulement par le pollen (chez les Cétoines par exemple), l’abeille dépend encore davantage des fleurs. En effet, si les abeilles mâles et femelles doivent consommer du nectar et du pollen pour se nourrir, les femelles doivent en plus récolter du pollen (source de lipides et de protéines), qu’elles mélangent à du nectar (source de sucres) pour confectionner des «pains de pollen». Pour quoi faire? Pour régaler leur couvain. Autrement dit, si les larves des coléoptères, diptères et lépidoptères ne dépendent pas des adultes pour survivre, c’est l’inverse chez l’abeille. Autant dire que chez elle, le butinage n’est pas qu’une bronzette sur fleur, paille au bec. Non, dans son cas, la fleur relève d’un enjeu de conservation intégral, de l’œuf à l’adulte. Il lui faut donc être beaucoup plus énergique et efficace dans ses visites florales que la moyenne des autres pollinisateurs.

Œuf d'Osmie cornue (Osmia cornuta) pondu sur pain de pollen... Et dans la coque plastique d’un taille-haie!
On peut ainsi considérer l’abeille comme une sorte de Charlot des «Temps modernes», version butinage à la chaîne. Et puisqu’il est question de rendement, voulez-vous des chiffres pour illustrer notre propos? Ils sont plutôt parlants:
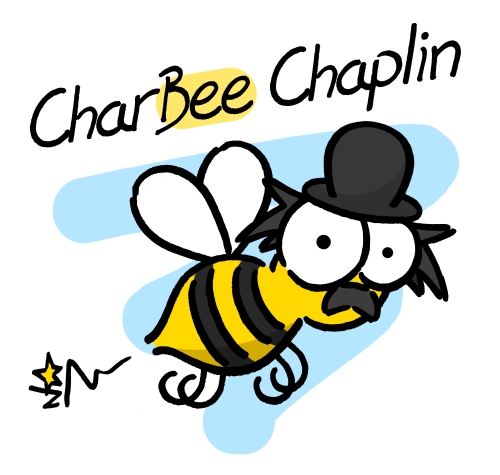
On estime que 75 à 80% de la flore sauvage européenne et près de 70% des espèces de plantes cultivées dans le monde (pommes, melons, courges, café, tournesols, etc.) dépendent en grande partie de la pollinisation par les abeilles. D’un point de vue quantitatif, cela ne représente qu'un tiers des aliments que nous consommons au quotidien car notre alimentation repose sur les céréales, lesquelles sont pollinisées par le vent. En revanche, ce tiers est composé de nombreux fruits et légumes qui contribuent à la diversification de notre alimentation, donc à notre santé.
Un dernier chiffre est éloquent: en 2005, la valeur économique annuelle mondiale des produits de la pollinisation par les abeilles s’élevait à environ 150 milliards d’euros.
Fort de ce constat, la petite équipe de Sauvages du Poitou avoue avoir un faible pour cet insecte qui force le respect.
«Quand on parle pognon, à partir d’un certain chiffre, tout le monde écoute.»
(Le Pacha, Georges Lautner)
Mais avant de détailler les particularités de la pollinisation par ces «mouches à quatre ailes» (comme les appelait le naturaliste Réaumur au XVIIIème siècle), mesurons d’abord ce qui se cache derrière le nom «abeille». Force est de constater qu’il est excessivement réducteur: il renvoie essentiellement à l’Abeille mellifère, notre fameuse Abeille domestique, Apis mellifera. La vérité, c’est qu’il cache aussi une variété étonnante d’abeilles sauvages. En France, on en dénombre environ 970 espèces, et ce peuple est si discret et méconnu qu’on y découvre de nouvelles chaque année. Essayons ensemble d’y voir plus clair en brossant rapidement cette belle variété. En France, six familles sont présentes :
- Les Apidés: 19 genres, vaste famille, très variée, comprenant notamment notre célèbre
Abeille domestique mais aussi les Bourdons (environ 50 espèces en France), les Xylocopes et
autres genres moins connus.

Xylocope violet (Xylocopa violacea): un gros spécimen (jusqu'à 5cm d'envergure) chez les abeilles!
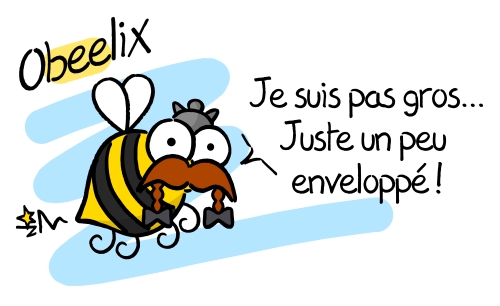
- Les Megachilidés: les Mégachiles, les Osmies etc. Plus de 200 espèces en France. Cette famille forme
là aussi un ensemble très vaste, avec des abeilles d’allure généralement compacte. Pour vous en
donner une idée, peut-être connaissez-vous la très commune Osmie cornue (Osmia cornuta), une
abeille qui apparaît fin mars dans nos contrées, qui niche souvent dans les trous de fenêtres et qui
fréquente couramment les hôtels à insectes?

Osmie cornue, la squatteuse des trous de fenêtre.
- Les Colletidés: les Collètes et les Hylaeus. Plus de 70 espèces en France. Les Collètes ont un
air de ressemblance avec l’Abeille domestique tandis que les Hylaeus sont des petites
abeilles dont les mâles présentent un masque facial jaune.

Collète du lierre (Colletes hederae), inséparable du Lierre grimpant en Automne.
- Les Andrenidés: les Andrènes, les Panurgus etc. Environ 160 espèces en France. Les
Andrènes mesurent de 5 à 12 millimètres selon les espèces et certaines sont communes dans
les parcs et jardins. De leur côté, les Panurgus sont des abeilles minuscules qui se plaisent à
butiner en «nageant» sur le flanc dans les fleurs, notamment les pissenlits (elles sont très
faciles à repérer).

l'Andrène à pattes jaunes (Andrena flavipes), une espèce commune, ici sur Trèfle champêtre (Trifolium campestre).
- Les Halictidés: les Halictes, les Lasioglosses etc. Environ 160 espèces en France. Espèces de
quelques millimètres seulement pour nombre d’entre elles et dont certaines sont communes
dans les parcs et jardins, notamment l’Halicte des scabieuses (Halictus scabiosae), de la taille
de l’Abeille mellifère.
Quatre femelles d'Halictes des scabieuses, une abeille groupie des Astéracées rose/violette.
- Enfin, les Melittidés: les Dasypoda, Macropis et Melitta, 15 espèces en France. Considérons ces
espèces comme peu communes.
Ce pantalon XXL garni de pollen caractérise le genre Dasypoda.
Cela dit, si une grande diversité règne dans le monde des abeilles, celles-ci partagent entre-elles de nombreux points communs. D’abord, tout ce petit monde adore siroter le nectar niché au creux des fleurs. Par quels moyens? Grâce à une langue (ou glosse), long tube flexible et pointu permettant à l’insecte d'aspirer le divin breuvage.
«J'pris un homard sauce tomates, il avait du poil au pattes. Félicie… aussi.»
(Félicie, Fernandel)
On le voit, la manière qu’ont les abeilles d’accéder au nectar ne parait pas très difficile et, au fond, s’apparente à celle des mouches ou des papillons. Là où l’histoire se complique, c’est que l’abeille femelle doit aussi rassembler beaucoup de pollen pour sa descendance sans en perdre un grain entre deux inspections de fleurs. Heureusement, madame est remarquablement équipée de poils (appelées «brosses de récolte» ou «scopae») qui lui permettent d’emmagasiner le pollen. Selon les familles d’abeilles, ces brosses de récolte se situent soit sur les pattes postérieures (chez les Andrènes par exemple), soit sur la partie ventrale de l’abdomen (chez les Mégachiles).
Chez les Andrènes, les brosses de récolte se situent sur les pattes postérieures…
… Tandis que chez les Mégachiles (ici Megachile centuncularis), les femelles emmagasinent le pollen sous l’abdomen.
Résumons: les abeilles mâles et femelles possèdent une langue pour sucer le nectar et les femelles ont des poils pour récolter le pollen afin de nourrir leur couvain. Il s’agit donc d’un attirail au service de l’abeille. Car la fleur, elle, qu’a-t-elle à gagner là-dedans? Non seulement on lui enlève du nectar mais en plus, le pollen accroché aux brosses de récolte de l’abeille ne parviendra pas (ou peu) aux pistils. Heureusement, la fleur compte sur une autre spécificité de l’abeille (mâle comme femelle) pour assurer sa pollinisation. Cette caractéristique réside dans l’existence d’une pilosité couvrant l’ensemble du corps de l’abeille, notamment le thorax et l’abdomen.
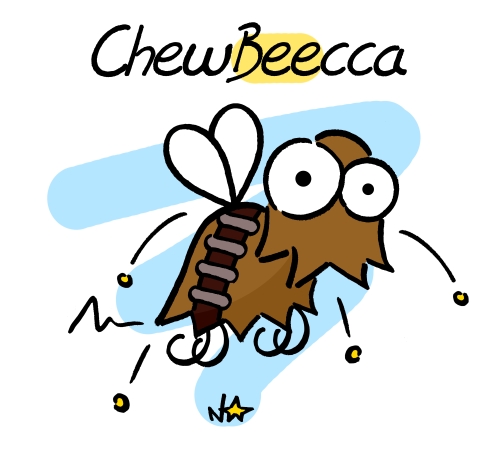
Qui plus est, cette pilosité s’avère plus dense que la moyenne des autres insectes floricoles. Et ce n’est pas tout, ces poils forment des soies plumeuses (ou «poils branchus») agissant comme de véritables scratchs à pollen, supérieurs aux soies simples des autres pollinisateurs. En somme, notons que tout a été prévu pour que le pollen vienne en masse adhérer aléatoirement au corps de l’abeille qui peut dès lors jouer les entremetteuses entre fleurs.
Les soies plumeuses distribuées sur l’ensemble du corps de cette Andrène lui ont permis d’accrocher
involontairement les grains de pollen d'un Pissenlit.
Cela dit, il faut enlever un poil à cette règle de la pilosité absolue. Car dans ce petit monde vrombissant,
il ne faut pas oublier un type d’abeille un peu spécial, celle que l’on désigne sous le nom d’«abeille
coucou» (ou abeille cleptoparasite). Des abeilles qui se comportent comme le coucou? Eh oui, chers
mélittophiles (=amis des abeilles)! Ces excentriques ont en effet la particularité de ne pas récolter de
pollen pour leur couvain mais de pondre sur le pain de pollen des abeilles «récolteuses». Une abeille
tire-au-flanc, en quelque sorte. Vous l’aurez compris, si ces dames aiment à licher le nectar, elles n’ont
donc pas besoin de brosses de récolte. Cette exception à la règle leur donne une allure plus glabre,
avec une tignasse plus clairsemée…

Exemple d'abeille coucou: les Nomadas (environ 90 espèces en France) qui ressemblent à des
guêpes. Notez que malgré une pilosité bien moindre que chez les abeilles «récolteuses», celles-ci
agrègent malgré tout du pollen, ce qui en fait des pollinisatrices incontestables.
Voilà, c’est tout pour aujourd’hui! Car ce n’est pas fini:
dans un prochain article, nous verrons
comment les abeilles repèrent et choisissent les fleurs qu’elles visitent... Ce qui n’est pas si
simple qu’il n’y paraît.
Les autres articles de Sauvages du Poitou consacrés aux insectes pollinisateurs:
Pour aller plus loin:
- L’Observatoire des abeilles, association française ayant pour objet l’étude, l’information et la protection des abeilles sauvages françaises (et des régions voisines) et de leur habitat. Elle édite la revue «Osmia» depuis 2007.- FlorAbeilles, à la découverte des fleurs butinées par les abeilles.
- «Pollinisation et pollinisateurs», conférence de Benoît Geslin sur les abeilles sauvages, leur écologie et les menaces qui pèsent sur elles, IMBE TV, 2018.
Deux livres «coups de cœur» recommandés par Sauvages du Poitou:

Jacinthe des bois, Poitiers bords de Boivre
Hyacinthoides non-scripta (Jacinthe sauvage ou Jacinthe des bois) appartient à la famille Liliaceae dans la classification classique, ou Asparagaceae dans la classification contemporaine. Elle rejoint donc le clan des Asperges (Asparagus, le genre type), du Muguet de mai, des Sceaux de Salomon, des Ornithogales («Dame d'onze heures» et «Aspergette») ou encore du Fragon.
Tous les trésors ne sont pas d'argent et d'or mon ami!
(Pirates de Caraïbes, Gore Verbinski)
La Jacinthe des bois est une Sauvage à la répartition typiquement atlantique: son aire se concentre sur la partie centre, nord et ouest de la France, et bien sûr au-delà sur les Iles Britanniques et en Belgique. Absente dans l'est du pays, rare aux frontières de ses limites de répartition, elle est une espèce déterminante, voire protégée dans plusieurs départements (en Nouvelle Aquitaine, elle est déterminante en Gironde ainsi que dans le Lot-et-Garonne). On retiendra surtout qu'elle est un trésor - le mot hyacinthe désigne également une pierre précieuse - et que par précaution, mieux vaut ne pas la cueillir pour en faire des bouquets, où que l'on soit!

La
Botanical Society of Britain and Ireland, la plus prestigieuse société botanique des Iles Britanniques, en a d'ailleurs fait sa mascotte (à travers un logo certes très stylisé). Il faut dire que la Jacinthe des bois, alias
Bluebell outre Manche (la «clochette bleue»), est la chouchoute du peuple anglais. En 2004,
Plantlife (un organisme de bienfaisance pour la conservation des plantes sauvages) organise une enquête visant à déterminer la fleur préférée de chaque grande ville des Iles Britanniques. Les organisateurs décident d'exclure la Jacinthe des bois du concours: sa cote de popularité est telle qu'elle anéantirait toute surprise ou variété dans les résultats!
Jacinthe des bois: lorsque sonnent les clochettes bleues!
La Jacinthe des bois est une
vivace (de par son
bulbe) qui colonise les sous bois frais, en plaine uniquement (sous 500m d'altitude). Elle fait parties du gang des
vernales, des forestières qui profitent du début de printemps pour fleurir, profitant des premiers rayons de soleil avant que le milieu ne se ferme avec le retour du feuillage des arbres.
Il n'est guère de spectacle plus réjouissant que le défilé des vernales au sortir de l'hiver, qui se succèdent selon un ordre rituel au fil des semaines:
Ficaires (parmi les plus pressées),
Pervenches,
Anémones,
Primevères, Jacinthes et finalement
Ail des ours,
Aspergettes... Un ballet très (trop!) éphémère, ces Sauvages disparaissant rapidement de la surface du sol pour roupiller sous terre jusqu'au printemps suivant.
Feuilles linéaires dressées puis recourbées de la Jacinthe des bois.
La Jacinthe des bois peut-être confondue avec une autre espèce très appréciée au jardin d'ornement: la Jacinthe d'Espagne (Hyacinthoides hispanica). Il faut dire que cette espèce horticole saute parfois la clôture pour s'ensauvager, répondant peut-être à l'appel de la forêt (dans les faits, la Jacinthe d'Espagne reste souvent à proximité des parcs et des habitations).
Jacinthe d'Espagne: une Jacinthe des jardins qui se prend parfois pour une Sauvage.
Cette fausse sauvageonne se distingue de la véritable forestière par ses touffes denses, ses feuilles plus larges, ses inflorescences non odorantes réparties en tout sens (l'inflorescence est plutôt unilatérale chez la Jacinthe des bois) et la pointe de ses pétales (
tépales) peu récurvés (ceux de la Jacinthe des bois sont franchement retroussés). Les deux espèces peuvent s’hybrider à l'occasion, donnant naissance à un spécimen stérile dépourvu de fruits (
Hyacinthoides × massartiana), délicat à distinguer de la Jacinthe d'Espagne mais empruntant quelques caractéristiques de sa parente sauvage: pétales plus recourbés, inflorescence plus ou moins unilatérale...
Les pétales (en fait des tépales) complètement recourbés de la Jacinthe des bois, la «Sauvage».
Dieu, c’est un type hyper jaloux.
(P.S. I Love You, Richard LaGravenese)
Toutes les Jacinthes empruntent leur nom à la mythologie grecque: Hyacinthe est un jeune et beau garçon. On peut imaginer qu'il incarne le charme sans égal du retour de la végétation au printemps. Il attise les désirs autour de lui, à commencer par ceux de Zéphyr (qui personnifie le vent) et d'Apollon (dieu de la beauté et de la pleine lumière, il est le soleil d'été). A cause de leur rivalité et de leur jalousie, Hyacinthe est tué... Afin que le pauvre garçon ne soit pas emporté au royaume des morts, Apollon le change finalement en fleur. Générique. Applaudissements!
Coffres à trésor (capsules trigones) de la Jacinthe des bois à la fin du printemps.
Pour aller plus loin:
 20/09/2020
20/09/2020


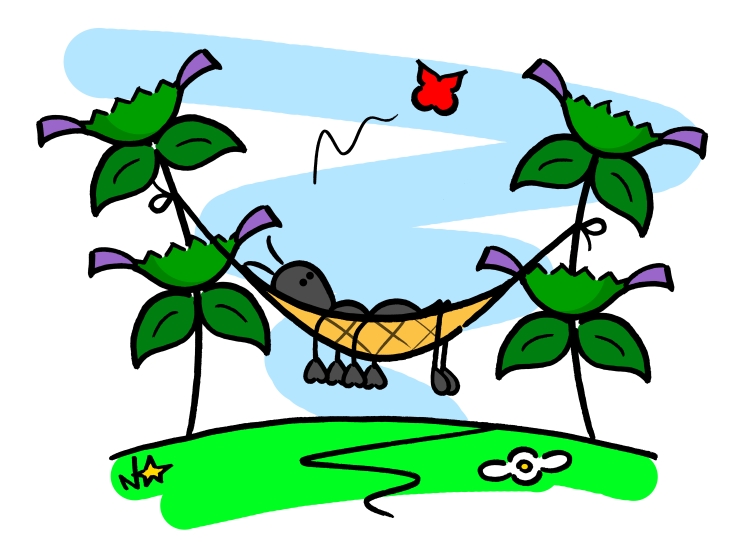








 06/05/2020
06/05/2020

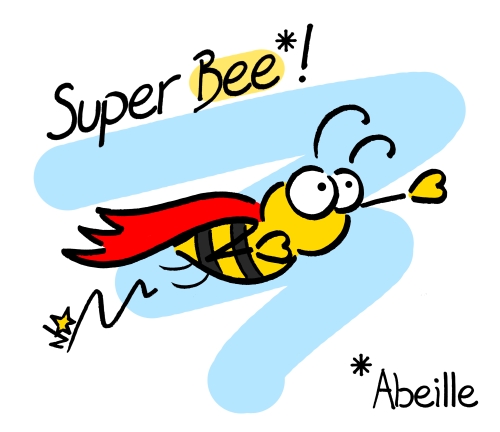

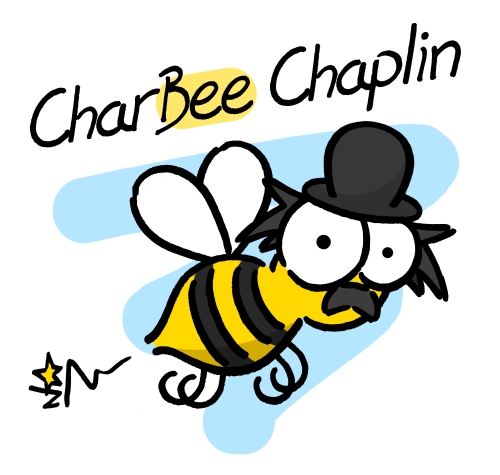

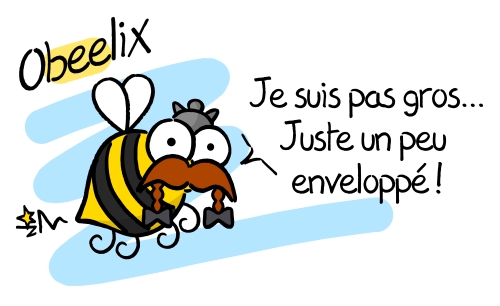





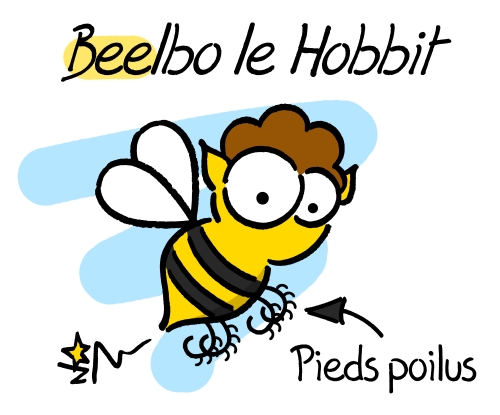


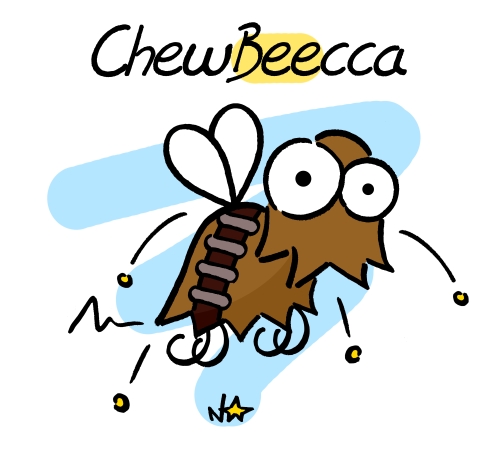



 13/04/2020
13/04/2020







