 26/07/2016
26/07/2016

Picride fausse vipérine, Poitiers bords de Boivre
Helminthotheca echioides (Picride fausse vipérine ou Cochet-marocain en poitevin-saintongeais) appartient aux clan Asteraceae, le clan des fleurs à capitules (une inflorescence fournie qui prend l'apparence d'une grosse fleur unique). On continue ce qui pourrait être notre feuilleton de l'été, celui des Sauvages à fleurs jaunes à la mode «Pissenlit» (Taraxacum sect. Ruderalia), à la suite des Séneçons (Senecio vulgaris, Jacobaea vulgaris) ou des Laiterons (Sonchus oleraceus, Sonchus asper) qui ont déjà tenu le haut de l'affiche sur Sauvages du Poitou.

Picride fausse vipérine, Poitiers bords de Boivre
La Picride fausse vipérine est une annuelle (parfois bisanuelle) peu discrète, dont la silhouette épaisse et velue est bien connue des jardiniers (diantre, de la mauvaise herbe!): la Sauvage fréquente les milieux habités par l'homme, les jardins, les champs cultivés, les vergers, les bords des routes... Autant d'endroit où elle trouvera une terre riche, bien exposée, tassée par le passage des pieds, des véhicules ou des machines (ses colonies les plus denses peuvent signer un sol à tendance calcaire).

Feuille rêche, ondulée, embrassante, velue (voir piquante) et «verruqueuse» de la Picride fausse vipérine.
Thérèse n’est pas moche. Elle n’a pas un physique facile... C’est différent.La tige et les feuilles hérissées de poils durs de la Picride fausse vipérine dessinent des contours grossiers (la Sauvage est d'ailleurs surnommé en Angleterre Bristly Oxtongue, la «Langue de bœuf hérissée»!), qui peuvent évoquer les traits de certains membres de la famille Boraginaceae. On peut penser par exemple aux feuilles de la Vipérine (Echium vulgare), dont la Picride fausse vipérine usurpe quelque peu le nom.
(Le père Noël est une ordure, Jean-Marie Poiré)
J’appelle pas ça voler, j’appelle ça tomber avec panache.
(Toy Story, John Lasseter)
Au centre du «pompon», les semences sont équipées d'un matériel de vol bien plus fourni et s'envolent au loin pour conquérir de nouveaux territoires.

Akène de la Picride fausse vipérine pris au piège dans une toile d'araignée: rougeâtres, surmontés d'un long pied qui porte les soies plumeuses.

Les jeunes feuilles de Picride fausse vipérine et Picride épervière sont comestibles, mais elles deviennent rapidement coriaces en gagnant en maturité (on peut alors éventuellement les faire cuire). De par ailleurs, elles doivent leur nom de Picride au suc amer et poisseux contenu dans leurs tiges, picros signifiant «amer» en grec. Vous voilà prévenus!
Pour aller plus loin:
- Helminthotheca echioides sur Tela botanica
- Helminthotheca echioides: identification assistée par ordinateur
- Picris hieracioides sur Tela botanica
- Picris hieracioides: identification assistée par ordinateur

L’Orobanche de la Picride (Orobanche picridis) est une plante parasite dépourvue de feuilles vertes (et donc de chlorophylle) qui plante ses suçoirs sur les racines de nos Picrides. Il existe de nombreuses espèces d’Orobanches aux floraisons spectaculaires (très difficiles à différencier les unes des autres); elles parasitent de manière quasi spécifique d’autres Sauvages: Orobanche du Lierre, du Trèfle, du Thym…
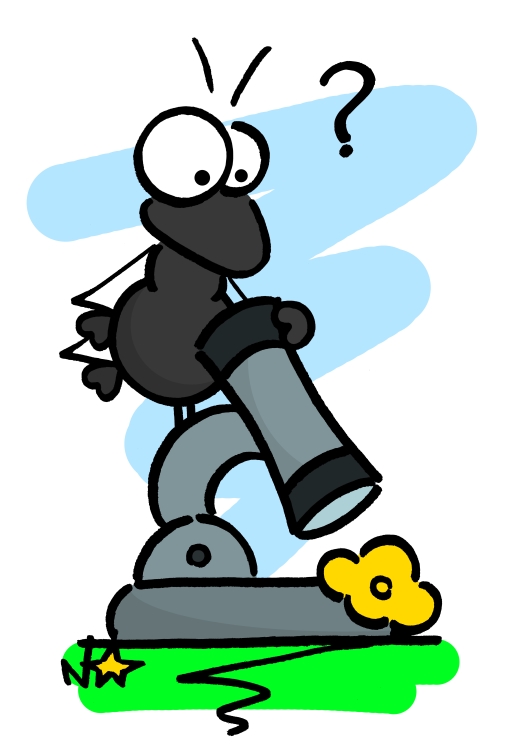
«Helminthotheca echioides»... Voilà un nom qui risque de ne pas vous encourager à retenir les noms latins de nos Sauvages! La Picride fausse vipérine s’appelait pourtant Picris echioides il y a quelques siècles (ce qui peut sembler plus évident pour une Picride). Au milieu du 18ème siècle, des études approfondies, menées à grands coups de loupes, ont abouti à la conclusion que la Sauvage méritait de quitter le genre des Picrides pour rejoindre un genre à part, celui des Helminthies... Et la voilà devenue Helminthie fausse vipérine (Helminthotheca echioides). Au 19ème siècle, certains chercheurs trouvent la distinction un peu tirée par les poils, et souhaitent réintégrer la Sauvage chez les Picrides. Fin 20ème siècle, les examens génétiques surpassent les loupes dans les laboratoires, et la démarcation entre Picrides et Helminthies trouve de nouveaux défenseurs et de nouveaux arguments. A suivre?
 03/06/2016
03/06/2016

Origan commun, Poitiers chemin de la Cagouillère
Origanum vulgare (Origan commun ou Marjelène en poitevin-saintongeais) appartient à la grande famille Lamiaceae, dont les membres présentent des tiges à section carrée et des fleurs en forme de bouche (voir l'article complet sur le sujet pour la petite histoire).
Son nom vient des mots grecs Oros et Ganos, respectivement «montagne» et «éclat». Origanum vulgare est donc la «beauté des montagnes», et on se demande bien pourquoi, dans la mesure où le Sauvageon trouve probablement ses origines autour du bassin méditerranéen (il peut pousser jusqu'à 2000 mètres d'altitude).
- C’est marrant, j’aurais juré que les montagnes rocheuses étaient plus rocheuses que ça.
- Ouais, ils racontent vraiment n’importe quoi à la télé.
(Dumb & Dumber, Frères Farrelly)

Origan commun, Poitiers chemin de la Cagouillère
De ses origines méditerranéennes, Origanum vulgare a gardé le goût des sols rocheux, arides, des rocailles bien exposées au soleil. Un simple mur peut lui suffire. Il est vivace et coriace: il supporte des température jusqu'à -15°C l'hiver et ne connait quasiment ni maladies, ni prédateurs dans des conditions ordinaires (on peut tout de même citer les chenilles de l'Azuré du serpolet, voir plus bas).

Fleurs de l'Origan commun: quatre étamines saillantes (deux d'entre elles dépassent nettement au dessus des lèvres) se dressent depuis une corolle formée d'une lèvre supérieure plane et échancrée et d'une lèvre inférieure étalée et trilobée.

Feuilles de l'Origan commun: opposées, entières (ou vaguement denticulées), ovales ou elliptiques.
Origanum vulgare se récolte (et se consomme) comme le Thym: on fait sécher les parties aériennes de la plante (sans les racines) en bouquets, pendus la tête en bas, dans un local bien aéré. A vrai dire, en cuisine, Origanum vulgare a
d'avantage d'odeur qu'il n'a de goût... L'Origan préconisé dans les recettes est généralement issu d'une autre Sauvage méditerranéenne, l'Origan marjolaine (Origanum majorana), cultivée chez nous comme une aromatique annuelle: une sudiste qui ne survit pas à l'humidité et au froid des hivers picto-charentais (mais réchauffement climatique oblige, les temps peuvent changer).
Pour profiter pleinement de la saveur d'Origanum vulgare, notre Origan sauvage et local, le mieux reste d'emprunter la recette du «thé solaire» au botaniste François Couplan: placer la plante dans une gamelle pleine d'eau et laisser quelques heures en plein soleil; dans ce mode d'infusion délicat (et poétique), les substances les plus volatiles seules sont extraites...

Tasse de thé solaire à l'Origan commun: pas besoin de réchaud!
Origanum vulgare améliorerait le transit et soulagerait les troubles digestifs et intestinaux (ballonnements et flatulences). Jadis, il a été considéré comme un philtre d'amour: quelques feuilles jetées discrètement dans l'assiette de son (ou sa) bien-aimé(e) pouvant faire pencher son cœur du bon côté. Dans d’autres versions, il servait à assaisonner la nourriture des ouvriers agricoles au Moyen-âge, pour leur donner le sourire et de par là même du cœur à l’ouvrage; les nourrices allaitantes le consommaient pour mettre leur bébé de bonne humeur. Bref, l’Origan apporte à nos pizzas une note de soleil, mais peut-être aussi une touche d’amour et d’humour !
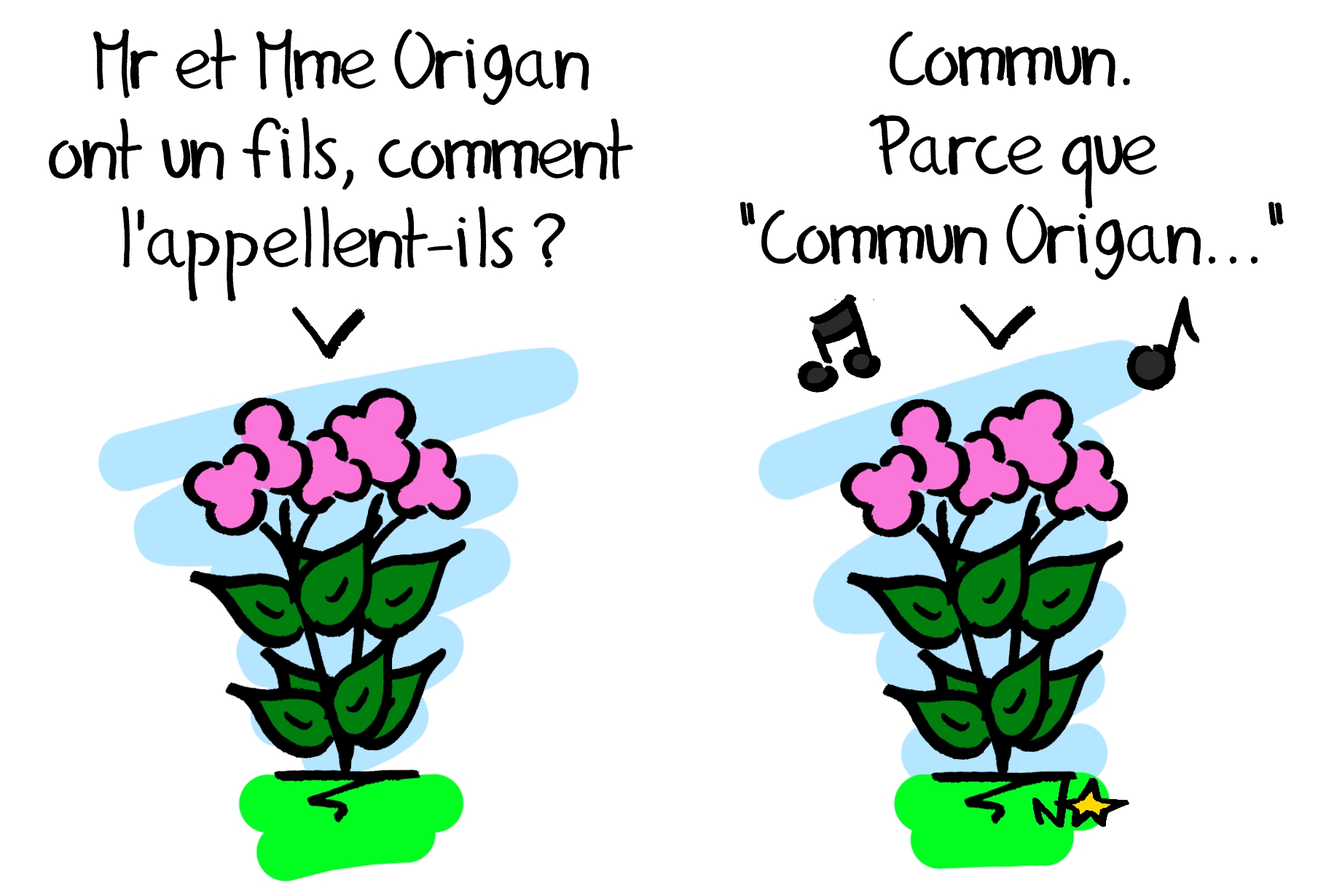

- Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer.A sa décharge, l’Azuré du serpolet est une espèce protégée qui se raréfie en France. Sa disparition est due à la nécessité pour le papillon de bénéficier dans son milieu tant de ses plantes hôtes (Origan commun ou Thym serpolet) que d’un nombre suffisant de fourmilières de Myrmica. En Poitou-Charentes, elle est considérée comme assez rare. Aussi, si vous la croisez, admirez la magie de son vol bleu, rapide et nerveux, et oubliez ses mœurs de hors-la-loi!
- Un quoi ?
- Un tueur en série.
- Ah! Un serial killer!
( La cité de la peur, les Nuls)
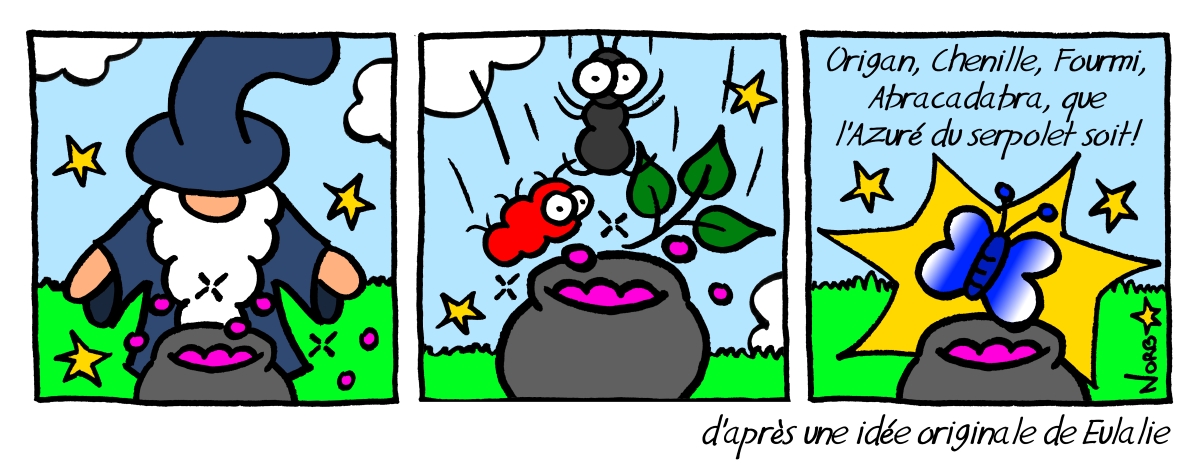
- Origanum vulgare sur Tela-botanica

Origan commun à la fin de l'été: les fleurs disparaissent peu à peu, reste le spectacle fascinant des bractées pourpres.
 23/03/2016
23/03/2016

Bourrache officinale, Poitiers quartier Chilvert
Borago officinalis (Bourrache officinale ou Borage en poitevin-saintongeais) fait office de chef de clan chez les Boraginaceae, dont les membres affichent souvent un système pileux très développé (Consoudes, Buglosses, Vipérines, Myosotis...)! Son nom viendrait du latin burra, la «burre», une étoffe en laine grossière qui habillait les moines: une référence à la texture de ses feuilles rêches, garnies de poils durs.

Bourrache officinale, Poitiers bords de Clain
Borago officinalis est une anuelle à croissance rapide. Elle aime l'eau, les sols riches en matière organique et les nitrates. Elle commence sa floraison dès que le pied atteint une quinzaine de centimètres (ce qui ne l'empêche pas de continuer à grandir ensuite): comme toute annuelle qui se respecte, la Sauvage vit dans l'urgence de la reproduction! En tout et pour tout, Borago officinalis est capable de fleurir 8 à 10 mois dans l'année...
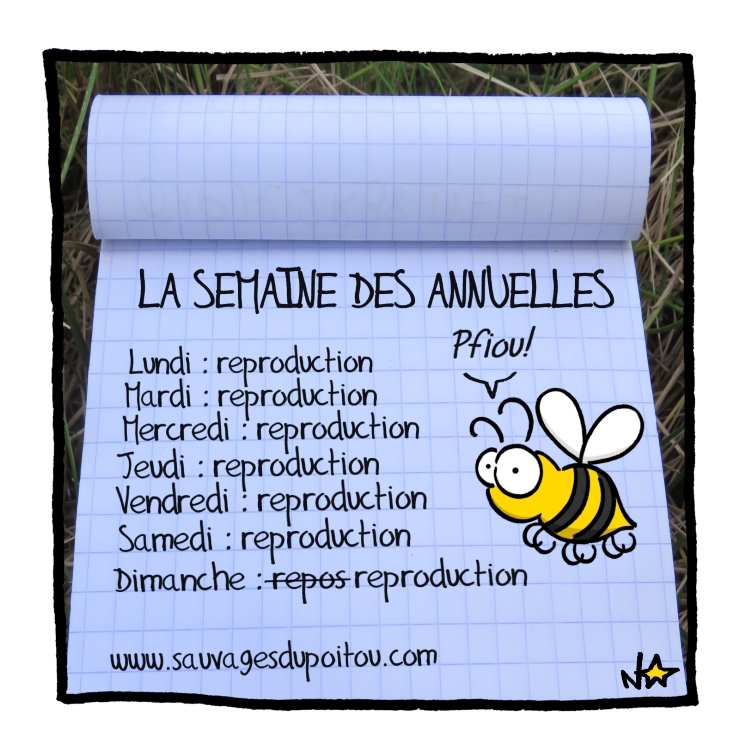


Borago officinalis est une plante mellifère de première classe, au même titre que la Phacélie (Phacelia tanacetifolia) et la Vipérine (Echium vulgare), deux autres membres du clan Boraginaceae) semées par les apiculteurs pour booster la production. Les abeilles en raffolent, et c'est leur faire un beau cadeau que d'entretenir quelques pieds au jardin.

Fleur de Bourrache officinale: 5 sépales, une corolle bleu intense à 5 lobes, 5 étamines en cône autour du pistil. Une Sauvage qui se butine la tête en bas! (abeille solitaire, Anthophora sp.)
Borago officinalis est une célèbre comestible: elle a été (et est encore) cultivée pour ses feuilles, ses fleurs ou ses graines. Des études récentes révèlent pourtant la présence d'alcaloïdes hépatotoxiques (concentrés dans la feuille et les tiges) susceptibles d'augmenter les risques de tumeur au foie (de même que chez la Consoude). Certes, personne n'est jamais tombé raide mort en croquant la belle; n'empêche que la considérer comme un met inoffensif est discutable (disons qu'il faudrait aussi considérer qu'un verre de vin est complétement inoffensif). S'il n'y a pas de quoi la rayer définitivement des assiettes, il convient de ne pas faire de Borago officinalis un régime soutenu et régulier.


Feuilles hérissées de poils piquants de la Bourrache officinale: alternes, les supérieures sessiles et embrassantes, les inférieures ovales et longuement pétiolées (pétiole ailé).
La Sauvage a pourtant été cultivée en tant que légume dans bon nombre de pays d'Europe (Espagne et Pays-bas par exemple), même si elle constitue rarement un plat principal; elle est généralement utilisée en accompagnement ou en assaisonnement dans les recettes. Crue, en salade (gare aux poils piquants!), Borago officinalis présente un léger goût iodé (certains diraient un goût d'huitre) inimitable.
- C’est la dernière fois que j’achète des fruits chez toi Tom! C’est ce que tu appelles frais? Il y avait plus de petites créatures poilues dans tes fruits qu’il n’y avait de fruit. Tu devrais ouvrir une boucherie, pas une épicerie.
(Arnaques, crimes et botanique, Guy Ritchie)
Ses feuilles peuvent ainsi agrémenter une omelette ou une soupe (gardez à l'esprit leur relative toxicité)... On peut aussi les faire frire en beignet, salés ou sucrés (en Grande Bretagne, on en fait d'excellent desserts au miel). Quant aux fleurs, inoffensives et comestibles (vous pouvez vous lâcher), elles sont très en vogue dans les restaurants où elles décorent agréablement les plats!

Colonie de Bourrache officinale, Poitiers bords de Clain
Au fil de l'histoire, Borago officinalis s'est taillée une solide réputation de plante médicinale. Grecs et romains considéraient la Sauvage comme une source... De courage et de joie. Les fleurs de la plante, macérées dans du vin, étaient consommées pour se donner du baume au cœur avant la bataille, ou pour guérir les esprits mélancoliques. Certains auteurs rapprochent le nom Bourrache du celte barrach, «courage», peut-être parce que la Sauvage insufflait la bravoure à celui qui la mangeait ou la portait à sa boutonnière.
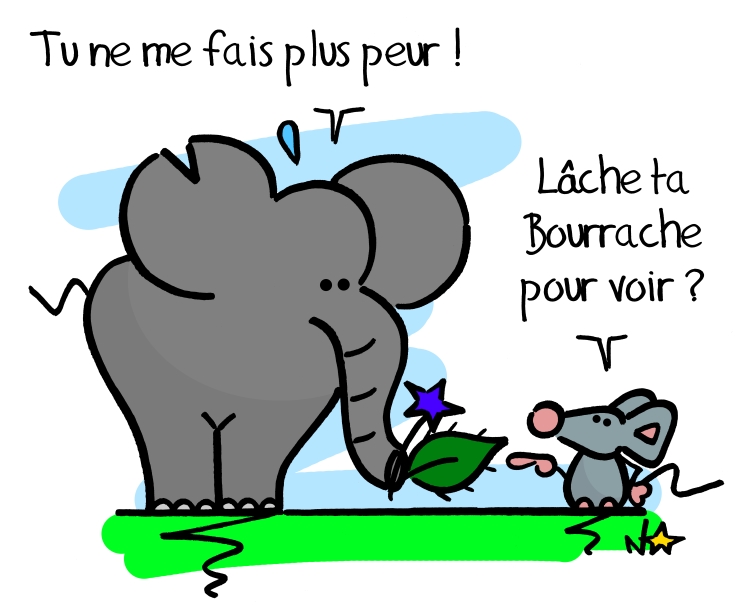
Borago officinalis a aussi été utilisée en médecine populaire pour soigner et adoucir la toux (peut-être à cause de sa richesse en mucilage lorsqu'elle est cueillie fraîche), ou pour ses pouvoirs sudorifiques (pour d'autres, c'est là que se trouve l'origine de son nom: abû araq — Bourrache — signifiant «père de la sueur» en arabe).
En usage externe, la Sauvage est aujourd'hui proposée sous la forme d'une huile (onéreuse) tirée de ses graines, qui présenterait des vertus adoucissantes, assouplissantes et revitalisantes... Bref, une caresse et un véritable élixir de jouvence pour la peau!
Est-ce parce qu'elle a l'air suspecte, mal rasée et un poil toxique que la Bourrache n'attire presque aucune chenille de papillon de jour? Allez savoir... Toutefois, nous avons dit «presque»: il arrive que notre sauvage régale la chenille du Petit Nacré (Issoria lathonia), même si elle est loin d'égaler les Violettes, largement préférées par le papillon. La Bourrache n'est ainsi pas souvent citée dans la littérature comme plante-hôte larvaire du Petit Nacré. En Provence, le fait est avéré mais il demeure rare («La vie des papillons» de Tristan Lafranchis, 2015). Dans l'ouest de la France, seules deux observations en 1897 et 1912 attestent cette «relation» entre Bourrache et Petit Nacré ! («La lettre de l'Atlas Entomologique Régional n°14», mars 2001).

Le Petit Nacré, ici sur une Centaurée (Centaurea sp), recto verso!
Pour aller plus loin:
- Identification assistée par ordinateur
-Borago officinalis sur Tela-botanica

Une Bourrache aux fleurs blanches comme neige? Les cas de dépigmentation ne sont pas rares chez les végétaux. Ce phénomène est peut-être dû à la mutation ponctuelle d’un des nombreux gènes qui participent à la synthèse des pigments et donc des couleurs des feuilles ou des fleurs.
