 30/08/2017
30/08/2017

Galeopsis tetrahit, Biard (86)
Galeopsis tetrahit est une de ces rares Sauvages qui porte le même nom en latin comme en français (d'après le référentiel de l'INPN, elle a bien sûr en pratique des surnoms pittoresques suivant les régions, tels que Chanvre sauvage ou Chanvre bâtard). Membre évident des Lamiaceae, le clan des Sauvages à fleurs en forme de bouche (voir notre article complet sur ce sujet), le Galéopsis tetrahit porte fidèlement, jusque dans son nom, sa gueule grande ouverte: Galeopsis est littéralement en grec «celui qui a l'aspect de la belette».

Fleurs purpurines du Galéopsis tetrahit à la fin de l'été: une corolle en tube muni de deux lèvres. La lèvre supérieure est hérissée de poils, comme pour dire aux butineurs: «c'est en dessous qu'il faut se poser!»
Quoi ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule?
(Johnny Hallyday, Ma gueule!)
Difficile de dire si les fleurs du Sauvageon ressemblent à un museau de mammifère, mais souvenez vous qu'une autre Lamiacée, le Lamier jaune (Lamium galeobdolon), portait déjà le sobriquet de «celle qui pue la belette» (traduction de galeoblolon en grec). Il faut croire que Carl von Linné, le saint patron des botaniste, était dans sa période belette lorsque qu'il baptisa les deux spécimens!

A l'image des nombreux Lamiers, ses proches cousins, on pourrait confondre le Galéopsis tetrahit avec la Grande Ortie (Urtica dioica). Le Lamier jaune (Lamium galeobdolon) est surnommé «Ortie jaune», le Lamier blanc (Lamium album) «Ortie morte», le Lamier pourpre (Lamium purpureum) «Ortie rouge»... Le Galéopsis tetrahit s'en sort mieux que ses congénères puisque beaucoup préfère l’appeler «Ortie royale»! Une référence à son port prestigieux (jusqu'à 1 m de hauteur), ou à ses couronnes d'épines (ses calices) qui peuvent surprendre celui qui s'y frotte.

Calice hérissé de 5 pointes du Galéopsis tetrahit (notez le renflement caractéristique de la tige sous les nœuds).
C'est bien sûr un tort que de confondre le Galéopsis tetrahit avec la Grande Ortie. De plus, un œil averti notera quelques excentricités qui démarquent le Galéopsis tetrahit de ses cousins Lamiers: ses feuilles présentent des nervures pennées (rangées comme des arrêtes de poisson), alors que les Lamiers affichent un réseau de nervures complexes (réticulées). Coquetterie supplémentaire, on peut observer un léger renflement sous chaque nœud le long de la tige.
le Galéopsis tetrahit est une annuelle assez polymorphe qui colonise les lisières et les clairières des forêts alluviales. Ailleurs (friches, bord des routes ou dans votre jardin), il signe des sols frais mais lumineux, riches et chargés en matière organique végétale. Son expansion peut se montrer exubérante lors des coupes forestières, le Sauvageon prenant tous ses concurrents de court (jusqu'aux jeunes pousses d'arbres) dès le retour de la lumière. Introduite dans le nord des États-unis au cours du 20ème siècle, sa vigueur lui doit d'être considérée comme une invasive potentielle outre Atlantique.

Alors je vais tenter de l'anglo-normand. Avec un petit chromosome de tarbais pour améliorer les antérieurs. Qu'est ce que t'en penses?
(Le cave se rebiffe, Gilles Grangier)
Dans la nature, des hybridations entre espèces proches sont toujours possibles. Elles aboutissent le plus souvent à l'apparition de spécimens aussi fascinants que stériles (tout le monde connait le cas du mulet, croisement entre un âne et une jument).
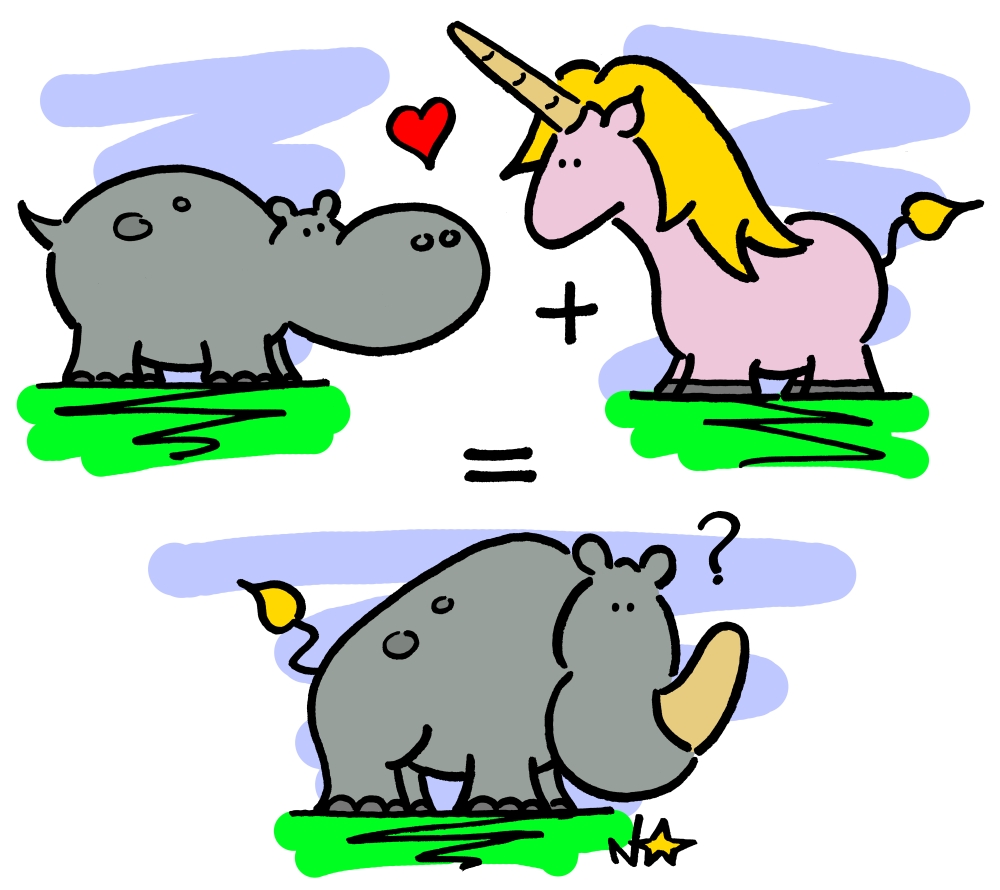
Dans le domaine très créatif du végétal, il n'est pas rare que ces hybridations produisent de nouvelles espèces fertiles: c'est le cas pour notre Galéopsis tetrahit, qu'on sait aujourd'hui issu de l'hybridation naturelle entre d'autres Galéopsis (G.speciosa et G.pubescens). Son nom d’espèce, tetrahit, exprime le doublement de ses chromosomes: le Galéopsis tetrahit est «tétraploïde», c'est à dire qu'il possède un double stock de chromosomes issus de ses parents, dont les bagages chromosomiques dissemblables ne pouvaient que s’additionner, pas s'assembler.

Très mellifère, l'Ortie royale offre un festin de roi aux butineurs.
Tout hybride qu'il est, le Galéopsis tetrahit n'en reste pas moins une Lamiacée: il est mellifère, aromatique et médicinal. Réputé antianémique, reminéralisant et astringent (pour sa haute teneur en silice et en tannin), le Sauvageon est bien sûr comestible, même si sa consommation n'est pas chose courante. On peut lire dans les ouvrages de l'ethnobotaniste François Couplan que les feuilles du Galéopsis tetrahit auraint été consommées régulièrement en Pologne, bouillies et servies avec de la pomme de terre, de la farine d'avoine et du lait. Reste que sa forte odeur risque de dissuader les cueilleurs: pour certains, le Galéopsis tetrahit se caractéristique d'avantage par un parfum de belette que par une gueule de belette!
Pour aller plus loin
- Galeopsis tetrahit sur Tela-botanica
- Galeopsis tetrahit: identification assistée par ordinateur

Chrysomèles du Galéopsis (Chrysolina fastuosa) dos à dos sur le Galéopsis à feuilles étroites (Galeopsis angustifolia), une des 10 autres espèces de Galéopsis présentes en France.
 12/05/2017
12/05/2017

Muscari à toupet, Biard Petit Mazay (86)
Muscari comosum (Muscari à toupet) appartient à la famille Asparagaceae (ex Liliaceae) dans les classifications récentes, le clan des Asperges, mais aussi de la Dame d'Onze heures, du Muguet de mai ou du Fragon déjà chroniqués dans les pages de Sauvages du Poitou. Les Muscaris doivent leur nom au Muscari musqué (Muscari macrocarpum), une Sauvage moitié turque, moitié crétoise, dont les fleurs jaunes et pourpres dégagent une odeur de «musc». Mais malgré son patronyme, notre Muscari à toupet ne dégage aucun parfum.

L'incroyable danse des Muscaris à toupet, Biard aéroport (86)
Muscari comosum trouve également ses origines autour du bassin méditerranéen (Turquie, Iran...). La Sauvage en garde un goût prononcé pour la lumière, les sols riches, sablonneux et bien drainés. En France, c'est une locataire des plateaux calcaires et des bords de routes baignés de soleil où elle plante ses bulbes (elle est vivace).

Épis de fleurs du Muscari à toupet, entre authenticité et contrefaçon végétale...
Entre fin du printemps et début de l'été, l'inflorescence à nulle autre pareille du Muscari à toupet mélange fausses fleurs violettes hérissées (stériles) à son sommet et fleurs fertiles, aux couleurs plus ternes, disposées en grappes lâches en dessous.
Comosum est la «chevelure» en latin: si la Sauvage se coiffe avec un pétard, c'est sans doute pour augmenter ses chances d'attirer les butineurs qui trouveront finalement le précieux nectar dans ses fleurs fertiles, plus discrètes.

Le Muscari à toupet est une monocotylédone qui présente de longues feuilles linéaires, repliées en gouttière. Avant floraison, ses feuilles s'étalent mollement sur le sol, formant un méli-mélo de boucles serpentiformes, ce qui lui vaut le surnom d'Ail-à-la-Serpent en poitevin-saintongeais.

Feuilles linéaires repliées en gouttière du Muscari à Toupet
À l'image de certaines Liliacées (sa famille dans la classification classique) comme l'oignon, l'ail ou l’échalote, les bulbes du Muscari à toupet sont comestibles après cuisson. Ébouillantés dans de l’eau vinaigrée, ces petits «oignons sauvages» sont salés, poivrés et mis en bocal dans de l'huile d'olive. Ainsi, les «lampascioni» (littéralement les «petites torches») sont des condiments incontournables de la cuisine italienne (région des Pouilles) où ils accompagnent les viandes. Malheureusement, les colonies de Muscaris à toupet que j'observe en Poitou sont peu denses. Tenter une récolte leur serait préjudiciable, mieux vaut se rabattre sur une épicerie italienne qui nous fournira des bulbes issus des cultures!
- Je parie que tu es super jolie les cheveux détachés.
- Mais ils sont détachés...
(Jackpot, Tom Vaughan)
On peut croiser dans les mêmes milieux un autre Muscari, un poil plus précoce dans la saison, aux feuilles filiformes et à la floraison nettement moins spectaculaire: le Muscari à grappes (Muscari neglectum; attention, il existe d'autres espèces proches, c'est un genre assez subtil).

Le discret Muscari à grappes (Biard, 86)
Ici, pas de punk attitude, juste une petite grappe de fleurs violettes dégageant une légère odeur de prune... Très loin de l'extravagance d'un Muscari comosum 'plumosum', un cultivar monstrueux du Muscari à toupet issu de l'horticulture, dont l'inflorescence explosive (entièrement stérile) ferait passer les membres du groupe The Cramps pour un boys band d'opérette!

Fruits (capsules) du Muscari à toupet en juin, Biard Petit Mazay (86)
Pour aller plus loin:
- Muscari comosum: identification assistée par ordinateur
- Muscari comosum sur Tela-botanica
- Muscari neglectum: identification assistée par ordinateur
- Muscari neglectum sur Tela-botanica
- Lampascioni, des bulbes mangés dans les Pouilles

Mélitée du Plantain (Melitaea cinxia) sur Muscari à toupet: on frôle la crise d'épilepsie devant tant de couleurs!
 09/03/2017
09/03/2017

Drave de printemps, Poitiers quartier Chilvert
Draba verna (Drave de printemps) appartient à la famille Brassicaceae (ex Crucifères), dont les membres présentent des fleurs à quatre pétales «en croix». En la croisant sur le trottoir, on pensera immédiatement à ses sœurs les plus urbaines: Cardamine hérissée (Cardamine hirsuta), Capselle bourse à Pasteur (Capsella bursa-pastoris) ou Arabette des dames (Arabidopsis thaliana)...

- À quand le printemps a votre avis?
- Je le prédis pour le 21 Mars.
- Ha ha, oui, ça serait chouette!
(Un Jour sans fin, Harold Ramis)
Draba verna est aux vieux murs, aux pelouses rases et aux trottoirs ce que les hirondelles sont au ciel: l'annonciatrice du retour du printemps. Ses grappes de fleurs éphémères s'observent entre la fin de l'hiver et le mois d'avril. Mais cette prophète des beaux jours reste bien discrète et on risque fort de lui marcher dessus avant que de l'entendre: Draba verna est une des Sauvages les plus précoces de nos villes, mais aussi une des plus petites (une dizaine de centimètres pour les spécimens les plus costauds)!

Drave party sur les gravillons ! (Drave de Printemps, Poitiers bords de Boivre)
Un examen superficiel pourrait laisser penser que les minuscules fleurs blanches de Draba verna affichent huit pétales. Il n'en est rien: la Sauvage fait honneur aux armoiries de son clan en brandissant quatre pétales seulement, mais si profondément échancrés qu'ils semblent doublés. Reste à attendre une éclaircie pour observer ses atouts, les fleurs ne s'ouvrant qu'en présence d'un ciel lumineux et sans nuages.

Fruits ovales et fleurs de la Drave de Printemps: 4 pétales profondément échancrés, 6 étamines autour du pistil au centre.
Draba verna réserve souvent des surprises à ses observateurs. Polymorphe, la belle présente des variations (pilosité, taille des fleurs...) d'une localité à une autre, pouvant laisser croire aux botanistes les plus aguerris qu'ils viennent peut-être de dénicher le Saint Graal du macadam: une nouvelle espèce! Le piège est redoutable même sous les microscopes, certaines populations pouvant afficher leurs différences jusque dans le décompte de leurs chromosomes.

Feuilles spatulées de la Drave de printemps en rosette (jamais de feuilles caulinaires).
Il faut dire que la Sauvage dispose de peu de temps pour tenter de se reproduire, l'univers minéral qu'elle fréquente devenant un enfer aride dès la fin de sa première saison. Annuelle trop précoce pour pouvoir compter sur les butineurs, Draba verna est une Sauvages autogame qui assure toute seule sa pollinisation en un temps record (la plante est capable de se féconder elle même). Ses parties aériennes disparaitront complètement avant l'arrivée de l'été.
La variabilité de ses populations repose plus sur d'éventuelles mutations que sur le brassage génétique entre individus, ce qui peut expliquer pourquoi ses populations semblent «fixer» localement leurs spécificités avec le temps, telles de nouvelles espèces (les mutations pertinentes vis-à-vis du milieu risquant moins de se diluer au fil des générations que dans le jeu des croisements).
La mutation, c’est la clé de notre évolution. C’est elle qui nous a mené de l’état de simple cellule à l’espèce dominante sur notre planète!
(X-Men, Bryan Singe)
Alexis Jordan, botaniste lyonnais du 19ème siècle, collectionna dans son jardin des spécimens de Draba verna issus d'horizons variés. Après 30 années de culture, il dénombrait pas moins de 200 groupes différents pouvant répondre à la définition d’espèce (des groupes d'individus interféconds entre eux et morphologiquement proche mais peu enclins à se reproduire avec les membres des autres groupes). Nul doute que la Sauvage n'a pas fini d'alimenter les débats universitaires et botaniques.
Mais plutôt que de couper les tiges en quatre, retenons que chaque plante est unique et mérite qu'on lui prête notre attention!
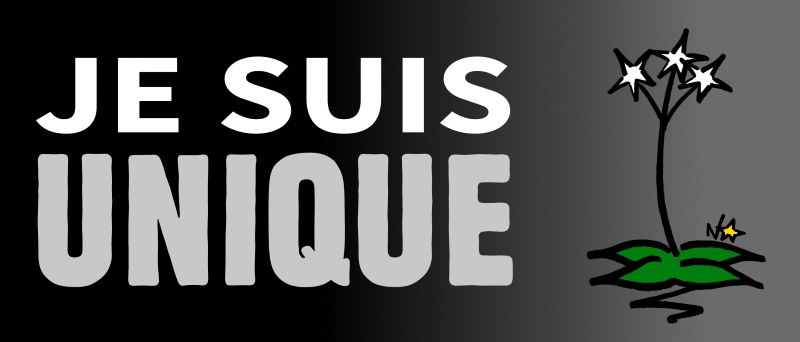

Les fruits (siliques courtes ou «silicules») de la Drave de printemps, guère plus impressionnants que les capsules d'une mousse! Le vent se chargera de disperser les minuscules graines...
Malgré sa discrétion, Draba verna est bien présente sur les cinq continents habités. Nommée Whitlowgrass par les anglophones à cause des adorables tapis formés par ses colonies (littéralement «la petite herbe blanche»), la Sauvage chante le printemps dans toutes les langues, tout autour du globe.

Une autre Drave qui fréquente les lieux secs, les rochers et les trottoirs, la Drave des murailles (Draba muralis). Elle se distingue avec ses feuilles dentées, les caulinaires embrassant la tige avec leurs oreillettes arrondies.
Pour aller plus loin:
- Draba verna: identification assistée par ordinateur
- Draba verna sur Tela-botanica
- La théorie de la mutation et les travaux d'Alexis Jordan par Hector Lebrun
- Draba muralis sur Tela-Botanica

Drave de Printemps représentée à l'échelle par Marie Corneille, artiste et botaniste des Deux-Sèvres (1889)... Un travail de fourmi! Une planche dénichée parmi les trésors du Fonds ancien de la bibliothèque universitaire de Poitiers.

