 05/07/2018
05/07/2018

Fleur de l'Aigremoine eupatoire, Marçay (86)
Agrimonia eupatoria (Aigremoine eupatoire ou Grimoine en poitevin saintongeais) appartient à prestigieuse famille des Rosaceae, celle des Roses bien sûr (on en compte plus de 40.000 variétés!), mais aussi celle des Framboisiers, des Mûriers, des Pommiers et autres géants producteurs de fruits: les Rosacées fournissent l'essentiel des fruits consommés par l'homme en zone tempérée. Leurs fleurs affichent souvent (ce n'est pas une règle absolue) cinq pétales et cinq sépales. Leurs feuilles alternes et généralement stipulées sont souvent composées et dentées. L'Aigremoine, faute de réjouir les amateurs de confitures, affiche fièrement ses armoiries familiales avec ses fleurs jaunes à cinq pétales, presque sessiles (en réalité très courtement pétiolées), réunies en grappes allongées et ses feuilles imparipennées profondément dentées.

Feuilles imparipennées de l'Aigremoine eupatoire, à 5-9 folioles ovales-lancéolés, profondément dentés, entremêlés de segments plus petits.
L'Aigremoine eupatoire est une vivace qui dresse ses grappes (30 à 60cm de hauteur) dans les prairies sèches, les taillis, les bords de route et de chemins en été (commune sur le territoire français, la belle se fait plus rare sur le pourtour méditerranéen).

Pour fuir la fournaise au ras du sol en été, rien de tel que de grimper sur un brin d'Aigremoine eupatoire!
L'Aigremoine doit peut-être son nom à son affection pour les friches, agrios étant le «sauvage» en grec et monias le «solitaire». Si l'Aigremoine est assurément un(e) Robinson(ne) des terrains vagues, l’étymologie de son nom mérite bien quelques paragraphes supplémentaires, tant la belle a déjà fait couler d'encre au cours de l'histoire...

Aigremoine eupatoire et Carotte sauvage (Daucus Carotta) méli-mélo: quand la nature fait de l'Ikebana.
Selon certains auteurs, c'est au souverain Mithridate VI Eupator (132-63 av.J.-C.) que l'Aigremoine emprunterait son nom d’espèce: eupatoria. On raconte que Mithridate consommait régulièrement diverses substances toxiques, à petite dose, afin de développer une résistance à l'égard tentatives d'empoisonnement sur sa royale personne. Bien sûr, Mithridate s'intéressait aussi aux antidotes: plusieurs Sauvages ont hérité du nom du roi botaniste, à l'image de notre Aigremoine eupatoire ou de l'Eupatoire à feuilles de chanvre (Eupatorium cannabinum), déjà croisée dans les pages de Sauvages du Poitou. Autant de plantes à qui l'on prêtait autrefois des vertus anti venin plutôt fantaisistes.
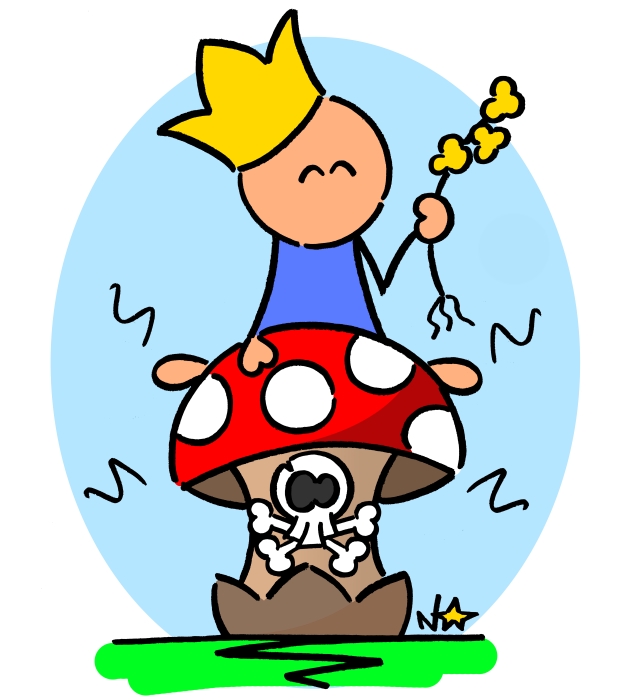
Au-delà de la légende du «Roi des poisons», eupatoria n'est peut être qu'une variation autour du grec hêpar désignant le foie, la Sauvage étant jadis prescrite pour remédier aux troubles hépatiques... Quant à son nom de genre, Agrimonia, il pourrait aussi évoquer une «taie de l’œil» en grec (une taie est une tâche qui se forme sur la cornée), l'Aigremoine ayant été citée dans des médications visant à soigner certaines affections oculaires.
Difficile de démêler le vrai du malentendu (je vous recommande sur ce sujet l'enquête du site Books of dante, voir lien en bas de page), mais l'Aigremoine eupatoire reste une médicinale indétrônable des manuels de médecine populaire et de phytothérapie. On lui prête plus sérieusement des qualités astringentes, cicatrisantes, antidiarrhéiques, antidiabétiques... Aujourd'hui encore, les sommités fleuries de l'Aigremoine eupatoire sont inscrites à très officielle «liste A de la pharmacopée française». Attention toutefois: une espèce jumelle moins commune, l'Aigremoine odorante (Agrimonia procera), ne présente nulle vertus médicinales connues, les deux espèces pouvant s'hybrider à l'occasion.

Fruits crochus de l'Aigremoine eupatoire (des akènes enveloppés dans les restes du calice) qui agrippent les poils et les vêtements des animaux de passage pour dissémination (zoochorie); ceux de l'Aigremoine odorante présentent des crochets extérieurs réfléchis vers la tige à maturité.
Elle est rugueuse votre tisane...
(Le Gendarme et les Extra-terrestres, Jean Girault)


Moins connue, l'utilisation de l'Aigremoine eupatoire à des fins tinctoriales permet de donner aux laines ou au coton une couleur d'or dite «nankin», quelque part entre l'abricot et le chamois: un doré tout à fait royal, disons... Eupatorien!

Aigremoine eupatoire: une ligne élégante tracée à l'encre d'or!
Pour aller plus loin :
- Agrimonia eupatoria sur Tela-botanica
- Agrimonia eupatoria : identifications assistée par ordinateur
- Agrimonia eupatoria à travers l'histoire sur le blog Books of Dante

Aigremoine eupatoire, Poitiers bords de Boivre
 01/05/2018
01/05/2018

Lathrée écailleuse (Lathraea squamaria), la star poitevine du 1er mai!
En ce premier mai, jour où il est bon de manifester son goût pour la nature, une trentaine de stagiaires attendent le botaniste Yves Baron (ancien maître de conférences en biologie végétale à l’université de Poitiers), route de la Cassette à Poitiers. Promesse est faite d'en apprendre un peu plus sur la Vallée de la Boivre (cette dernière est un petit affluent du Clain et emprunte son nom au vieux français «bièvre» désignant le Castor), sur un territoire classé Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique.

Les poitevins autour du professeur Yves Baron, serez-vous retrouver son chapeau?
Le groupe est conséquent, preuve s'il en fallait une de l'attrait pour la nature des poitevins. Pas de quoi décourager l'ancien professeur qui guidait autrefois les étudiants de l'université: parfois plus d'une centaine par sortie terrain! Quoi qu'il en soit, Yves Baron attire les botanistes comme les Lamiers attirent les bourdons: plusieurs groupes adaptés à l'étroitesse des chemins se forment naturellement autour du professeur et d'autres naturalistes éclairés.

La promenade débute sur les coteaux calcaires qui encadrent le fond de Vallée, royaume du Chêne pubescent (Quercus pubescens). C'est l'Aubépine monogyne (Crataegus monogyna) qui ouvre le cortège. Nous profitons de sa floraison parfumée tout en observant ses feuilles très découpée (pennatifides) qui la distingue de l'Aubépine à deux styles (Crataegus laevigata), aux feuilles doucement lobées, plus forestière, que nous croiserons plus tard en sous bois.


Un seul style au cœur des fleurs de l'Aubépine monogyne (en premier), 2 à 3 styles au cœur des fleurs de l'Aubépine à deux styles (en second).
Sur les coteaux, c'est encore l'heure de la discrète Potentille de printemps (Potentilla verna), première Potentille de l'année. Accrocheuse, la Garance voyageuse (Rubia peregrina) inaugure le défilé des Rubiacées qui suivront (Gaillets). Quelques Laitues sauvages (Lactuca serriola) orientent le groupe dans la bonne direction (on les surnomme les «Laitues boussole», voir l'article de Sauvage du Poitou). Au passage, Yves Baron nous apprend à faire un sifflet avec une tige de Pissenlit (Taraxacum sect. Ruderalia): la botanique s'apprivoise d'autant mieux avec le regard et le sourire de l'enfance.

De gauche à droite : Potentille de printemps, Garance voyageuse, Laitue scariole et Pissenlit.
En redescendant vers le fond de la Vallée, le milieu se referme; l'occasion de s'intéresser à quelques arbustes en passant: la Viorne lantane (Viburnum lantana) ouuvre ses jeunes feuilles comme une gueule de dragon. Quelques Cornouillers sanguins (Cornus sanguinea) bien exposés rougissent (de plaisir?). Le Troène d'Europe (Ligustrum vulgare) affiche des rameaux bigarrés, les feuilles d'hiver contrastant avec les nouvelles, plus claires. Au passage, on croise l'abracadabrantesque Daphné lauréole (Daphne laureola), une autochtone aux allures de plante exotique.

De gauche à droite : Viorne lantane, Cornouiller sanguin, Troène d'Europe et Daphné lauréole.
En bord de Boivre, la forêt alluviale reprend ses droits. C'est l'occasion de faire connaissance avec la Lathrée écailleuse (Lathraea squamaria, photo en tête d'article), une plante parasitaire, espèce déterminante pour la Vienne, rare sur le territoire français. Pas de Muguet de mai à l'horizon, mais le trésor du jour a pour compagnie le cortège des sauvages de sous-bois: Jacinthe des bois (Hyacinthoides non-scripta), Lamier jaune (Lamium galeobdolon), Ail des ours (Allium ursinum) ou encore Sceau de Salomon (Polygonatum multiflorum).

De gauche à droite : Jacinthe des bois, Lamier jaune, Ail des ours et Sceau de Salomon.
Au détour d'un chemin forestier, les promeneurs remontent finalement sur un versant calcaire. Le milieu s'ouvre à la lumière, offrant une prairie où les Orchidées poussent comme des pâquerettes dans un jardin. Il n'en faut pas plus pour que le groupe s'éparpille à quatre pattes... A chacun sa loupe, à chacun sa dose d’émerveillement!

La tête cramoisie de l'Orchis brûlé (Neotinea ustulata)... La faute à la loupe?
Le défilé du premier mai se termine en un bouquet fantastique: Orchis bouffon (Anacamptis morio), Ophrys araignée (Ophrys aranifera)... Il n'y a guère que la peu courante Véronique prostrée (Veronica prostrata) et l'excentrique Muscari à Toupet (Muscari comosum) pour rivaliser avec le gang des Orchidacées et tirer quelques derniers crépitements aux appareils photos!

De gauche à droite: Orchis bouffon, Ophrys araignée, Véronique prostrée et Muscari à Toupet.
 26/11/2017
26/11/2017

Lampsane commune sur le macadam, Poitiers quartier gare
Lapsana communis (Lampsane commune ou Géline en poitevin-saintongeais) appartient au vaste clan Asteraceae, la famille des fleurs à capitules (une inflorescence fournie qui prend l'apparence d'une grosse fleur unique). La Sauvage adopte dès l'été une dégaine très citadine, le style «Pissenlit» (Taraxacum sect. Ruderalia), avec ses capitules jaunes entièrement composés de fleurons ligulés jaunes (comprenez de petites fleurs en forme de languettes). Elle rejoint donc le célèbre gang à pompons jaunes des Séneçons (Senecio vulgaris, Jacobaea vulgaris), des Laiterons (Sonchus sp), des Picrides (Picris hieracioide, Helminthotheca echioides) ou autres Laitues (Lactuca sp)...

Feuilles inférieures lyrées (lobées, avec un lobe terminal beaucoup plus grand que les autres) de la Lampsane, une bonne piste pour la reconnaître.
La Lampsane est une annuelle qui affectionne les sols enrichis en azote (amendements excessifs, pollution...). Ses colonies se ressèment très efficacement (un pied peut produire de 500 à quelques dizaines de milliers de graines) dans les jardins, les zones de friches, les bords de route, les parcs ou les bois près des ville...

Capitule de Lampsane, Poitiers bords de Boivre
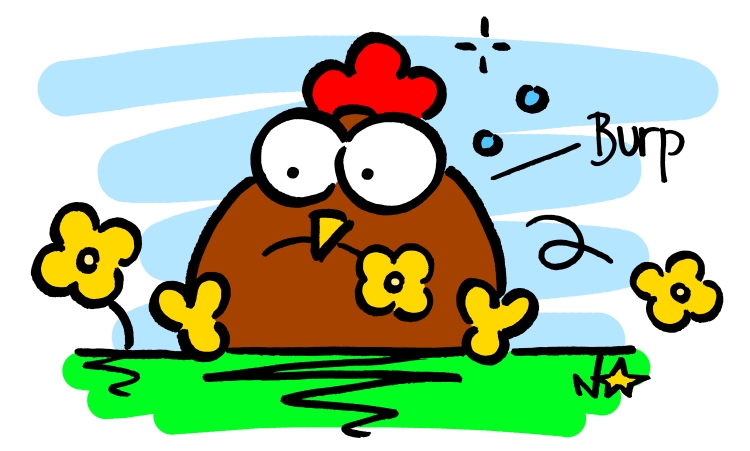
A moins d'élever des lapins (qui raffolent de ses feuilles) et des poules (qui se régalent de ses graines, à tel point que la Sauvage est parfois surnommée Poule grasse), la Lampsane peut prendre ses aises au jardin de manière spectaculaire, la belle pouvant atteindre un bon mètre de hauteur.
Toute annuelle qu'elle est, le botaniste Gérard Guillot (Guide des plantes des villes et des villages chez Belin) note qu'on observe parfois quelques spécimens vivaces de Lapsana communis. Ces derniers seraient des reliques de cultures anciennes (des variétés sélectionnées par l'homme), la Sauvage étant autrefois domestiquée dans les potagers, probablement depuis les temps préhistoriques.

Les fruits (akènes) de la Lampsane ne possèdent pas d'aigrettes, ces petites soies chères aux Astéracées qui permettent à leurs semences de s'envoler... Une inaptitude au vol qui n'empêche pas la Sauvage de se ressemer efficacement et abondamment.
Il faut dire que la Sauvage en a sous la feuille: tout d'abord, la Lampsane est une bonne comestible, même si elle gagne en amertume avec l'âge, une caractéristique que l'on retrouve chez nombre d'Astéracées (Pissenlit, Laitues...). En salade, on préférera les jeunes rosettes aux vieux pieds, plus fournis mais amers (leur amertume est moindre après cuisson).

Lampsane commune, Poitiers bords de Boivre
La Lampsane est surtout une célèbre médicinale, réputée diurétique (son nom viendrait du grec lapadzo, littéralement «je purge») et antidiabétique. A la fin des années 90, une étude pharmaceutique lui reconnait pas moins de 40 constituants chimiques (sans dangers pour la consommation humaine), dont les fameuses lactones que renferme le latex de plusieurs Astéracées, en partie responsable de leur amertume. Leur éventuel usage thérapeutique reste à défricher, mais nul doute que la Lampsane est loin de nous avoir livré tous ses secrets...
- T'as de sacrés beaux seins toi, j'aimerais bien avoir les mêmes... Les miens à côté c'est Laurel et Hardy!
(La Soupe aux choux, Jean Girault)
Surnommée Herbe-aux-mamelles (Nipplewort en anglais), la Sauvage était autrefois (parfois encore aujourd'hui) utilisée en cataplasme pour soigner les engorgements, les congestions et les crevasses des seins des mères et des nourrices. Pour certains auteurs, c'est à la bonne vieille théorie des signatures que l'on doit cette croyance ancienne, les capitules (ou plus exactement les jeunes boutons formés par les capitules sur le point de s'ouvrir) pouvant rappeler des mamelons.
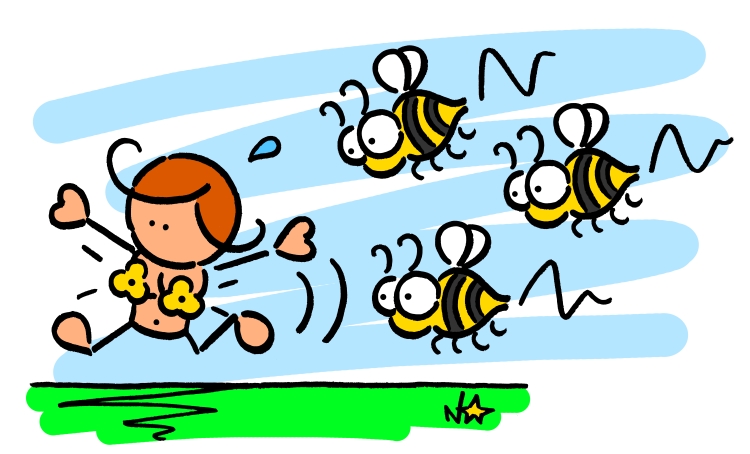

Jeune boutons floraux de Lampsane: il fallait avoir l'esprit drôlement placé pour y voir une grappe de mamelons, mais les naturalistes ont généralement l'esprit drôlement placé!
Pour aller plus loin:
- Lapsana communis sur Tela-botanica
- Lapsana communis : identification assistée par ordinateur

Chez la Lampsane, la ponte d’une petite guêpe spécifique (Timaspis lampsanae) peut provoquer un renflement sur la tige (une «galle»), dans lequel se cachent et se nourrissent les larves de l’insecte.
